In memoriam Noël Rixhon
Jubilation
Noël Rixhon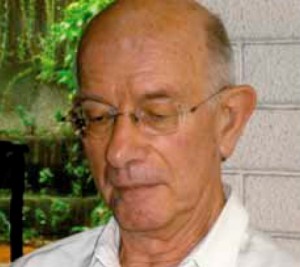 « Nous retournerons tous
dans l’état où nous étions
auparavant de naître
ou auparavant que d’être,
et comme il est sûr
que pour lors
nous ne pensions à rien
et que nous n’étions rien,
de même aussi il est sûr
qu’après la mort
nous ne penserons plus à rien,
nous ne sentirons plus rien
et nous n’imaginerons plus rien »1.
« Nous retournerons tous
dans l’état où nous étions
auparavant de naître
ou auparavant que d’être,
et comme il est sûr
que pour lors
nous ne pensions à rien
et que nous n’étions rien,
de même aussi il est sûr
qu’après la mort
nous ne penserons plus à rien,
nous ne sentirons plus rien
et nous n’imaginerons plus rien »1.
Mais bon dieu, faites les taire ! par Jean-François Jacobs
 Ah non, merde, encore un article sur Charlie Hebdo ! ... Mais bon dieu, faites les taire !
Comment ça, êtes-vous contre la liberté d'expression ? Enfin, contre ma liberté d'expression ?
Le bordel, le chaos, plus personne n’écoute, tout le monde hurle. Tout le monde juge, tout le monde condamne, tout le monde proclame... Tout et son contraire. C'est l'heure de la partouze onirique du « iladique ... » qui se vautre dans le « tavucom ... ». Tout va bien.
Ah non, merde, encore un article sur Charlie Hebdo ! ... Mais bon dieu, faites les taire !
Comment ça, êtes-vous contre la liberté d'expression ? Enfin, contre ma liberté d'expression ?
Le bordel, le chaos, plus personne n’écoute, tout le monde hurle. Tout le monde juge, tout le monde condamne, tout le monde proclame... Tout et son contraire. C'est l'heure de la partouze onirique du « iladique ... » qui se vautre dans le « tavucom ... ». Tout va bien.
Politique et religion. Illusions, déraisons et discussions par Patrice DARTEVELLE
Sur le thème "politique et religion", dans l'Europe entière tout est dominé par la présence nouvelle de l'islam sur le Vieux continent -même des auteurs américains passablement déconcertés en sont préoccupés- et l'incendie croissant au Moyen Orient.
Une approche inhabituelle « neuroscientifique » du phénomène religieux ?
Le point de vue des scientifiques : Le scientisme n'a plus cours depuis longtemps. Il n'est donc pas question, comme l'aurait sans doute fait en son temps le moine Guillaume d'Occam (1285-1347), de vouloir simplifier ou réduire l’infinie complexité du psychisme humain à des « mécanismes » psycho-neuro-physio-génético-éducatifs et culturels. D'autant moins du fait de la complexité inimaginable du fonctionnement cérébral humain, et a fortiori lorsqu'on tente de comprendre le phénomène religieux qui échappe à l'expérimentation scientifique. Certains scientifiques, agnostiques, déistes ou athées, ont néanmoins contribué peu ou prou à l'approche neuro-biologique de la foi, par exemple Henri Laborit, Antonio Damasio, Jean-Pierre Changeux, et surtout Patrick Jean-Baptiste. D’autres par contre, par exemple Jean-Didier Vincent, Pascal Boyer ou Richard Dawkins, sont plus réticents à proposer une hypothèse explicative quant à l'origine de la foi et à sa persistance.

