Athéisme et mouvements « radicaux » au sein de la colonie italienne d’Égypte (fin XIXᵉ – début XXᵉ siècle)[1]
Costantino Paonessa
Université de Bologne
Membre du Laboratoire de recherches historiques de l’UCLouvain
Le 7 juillet 1909, le ministre de l’Intérieur d’Égypte a informé l’agence diplomatique italienne du Caire que deux jours avant, une réunion s’était tenue au bar à vins « Fiaschetteria Falaschi », au cours de laquelle il avait été décidé de constituer un Circolo Ateo [Cercle Athée][2]. Il est fort probable que le projet ait commencé à prendre forme dès le printemps précédent et qu’il reflétait ce qui s’était passé à Alexandrie, où un Cercle Athée avait été inauguré en 1908. Si ce moment marque le point culminant de l’expression publique de l’athéisme dans la colonie italienne d’Égypte, ses racines plongent dans un terreau idéologique plus profond et ancien, nourri au fil du temps par les interactions entre les différents courants de pensée et groupes militants actifs dans la colonie depuis le XIXᵉ siècle.
La diffusion des théories et des concepts inspirés par la laïcité, la libre pensée, l’anticléricalisme, le scepticisme matérialiste et l’athéisme en Égypte, pendant la période allant de la prise du pouvoir de Mehmet Ali en 1805 et la Première Guerre mondiale, a suivi des trajectoires très similaires à celles d’autres courants de pensée et mouvements politiques qualifiés de « radicaux ». Le thème de la « non-croyance », tout comme celui de la liberté de conscience, n’était absolument pas inconnu des populations autochtones, puisqu’au cours des siècles, il avait fait l’objet de l’attention des savants appartenant aux différentes confessions et ethnies de la région. Toutefois, entre la fin du XIXᵉ et le début du XXᵉ siècle, la combinaison de nombreux facteurs en a partiellement modifié la portée[3].
En parallèle de cette riche et forte tradition « autochtone »[4], les profonds changements régionaux liés à ce qu’on a appelé la « première mondialisation », ainsi qu’à l’ampleur des réformes de modernisation entreprises par l’Empire ottoman et le gouvernement égyptien, ont facilité la diffusion d’idées et de pratiques venues principalement d’Europe. Ce processus s’est déroulé par le biais de deux canaux principaux. Le premier est lié au développement de nouveaux moyens de communication plus efficaces, tels que la navigation à vapeur, les services postaux et les journaux, qui ont facilité la diffusion rapide et à grande échelle des théories, concepts et publications imprimées à l’échelle internationale. Cela a permis aux élites intellectuelles locales d’accéder et de retravailler des idées provenant de l’extérieur de leurs frontières nationales, impériales ou culturelles. Le second facteur résidait dans les importantes vagues migratoires qui, entre le XIXᵉ et le XXᵉ siècle, ont poussé des dizaines de milliers de personnes à se déplacer en Égypte et dans la région, souvent pour des raisons politiques. Ce sont les migrants et les exilés qui ont favorisé la diffusion de la libre pensée, de l’anticléricalisme et de l’athéisme dans les colonies européennes en Égypte, en particulier au sein de la communauté italienne. Comparée à d’autres régions du monde, telles que les États-Unis ou l’Amérique latine, la propagation d’idéaux jugés « radicaux »[5] en Égypte a été possible grâce au système des Capitulations, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions juridiques régulant le séjour des citoyens en provenance des États européens dans l’Empire ottoman. Ce système juridique a été conçu à partir du XVIᵉ siècle comme une série de privilèges que l’Empire ottoman accordait aux sujets de certains États européens installés sur son territoire. L’objectif des accords capitulaires était double : d’un côté, ils assuraient aux étrangers la liberté d’établissement, de circulation, de commerce et de religion ; de l’autre, ils soustrayaient l’étranger à la loi du pays d’installation et à ses tribunaux, de sorte qu’il était jugé selon les lois de son propre pays par les tribunaux consulaires placés sous l’autorité des consuls. Au XIXᵉ siècle, en raison du changement de l’équilibre des pouvoirs en Méditerranée en faveur des États européens, le système des Capitulations avait transformé le statut des sujets résidant en Égypte, et leurs bénéficiaires (levantins, juifs, chrétiens de différentes provenances) disposaient d’un statut en quelque sorte similaire à celui des colons.
Associations patriotiques, ligues ouvrières et loges maçonniques : les origines de l’anticléricalisme, de la libre pensée et de l’athéisme en Égypte
Comme mentionné précédemment, la présence d’individus et de groupes s’inspirant de l’anticléricalisme et de la laïcité au sein de la colonie italienne d’Égypte est attestée depuis la première moitié du XIXᵉ siècle. À cette époque, de nombreux exilés du Risorgimento ont quitté l’Italie pour s’installer en Égypte, où ils ont trouvé des conditions favorables à la poursuite de leur engagement politique en faveur de la libération de l’Italie, ainsi que des opportunités d’emploi dans le vaste programme de modernisation lancé par les nouveaux gouverneurs du pays. Majoritairement installés dans les principales villes du pays, les démocrates et républicains, les carbonari [membres d’une société secrète qui préparait l’unification italienne], ainsi que de nombreux membres de loges maçonniques, ont fondé des associations inspirées des idéaux du Risorgimento, réussissant à fédérer rassembler une partie de la colonie autour des valeurs de l’unité nationale, réalisée entre 1861 et la prise de Rome en 1870[6].
Les vagues migratoires en provenance d’Italie, intensifiées après l’ouverture du canal de Suez en 1869, contribuèrent à renforcer un réseau hétérogène d’associations communautaires, patriotiques et ouvrières. Dans ce contexte, la libre pensée, et en particulier l’esprit anticlérical, nourri par le rôle réactionnaire de l’Église durant le processus d’unification italienne, ont occupé une position idéologique dominante. Bien que l’opposition à l’ingérence ecclésiastique dans la vie politique et sociale du nouveau Royaume d’Italie ait été largement partagée au sein des élites de la colonie italienne en Égypte, les formes d’expression de ce sentiment ont généré des divergences qui ont perduré jusqu’à la Première guerre mondiale. Ces tensions combinaient des éléments liés aux dynamiques nationales avec des enjeux spécifiques du contexte local[7].
En effet, l’arrivée en Égypte, à partir des années 1860, de migrants et d’exilés influencés par le mouvement garibaldien et républicain, ainsi que par le naissant mouvement socialiste, fuyant les difficultés économiques du pays et désillusionnés par l’évolution du processus d’unification, a entraîné des conséquences majeures dans la colonie. Le discours politique des associations ouvrières s’est déplacé vers un radicalisme politique plus marqué, fondé sur une dimension de classe, de justice sociale et d’internationalisme. Dans ce cadre, tandis que l’anticléricalisme des élites coloniales restait dans les limites du discours institutionnel, les groupes ouvriers et militants adoptaient une position ouvertement contestataire. L’attaque contre le pouvoir papal et les institutions religieuses s’inscrivait ainsi dans la contestation plus large de toutes les structures de pouvoir, et non seulement en soutien à un État laïque. La division entre ces deux interprétations de l’anticléricalisme a été particulièrement manifeste lors de la commémoration du XX septembre, qui marquait l’anniversaire de la prise de Rome.
À la fin du XIXᵉ siècle, dans le cadre de la politique expansionniste italienne, visant à contrer l’hégémonie franco-britannique en Méditerranée, le gouvernement italien et ses représentants en Égypte entament une politique de réconciliation avec l’Église et les missions religieuses. Cette initiative a suscité un vif mécontentement au sein de la colonie. Un des principaux points de dispute a été la fondation, en 1890, du cimetière laïque du Caire par un groupe d’associations libérales et de loges maçonniques, dirigé par la Società dei Reduci delle patrie battaglie [Société des vétérans des batailles patriotiques] probablement d’inspiration garibaldienne. Inspiré des cimetières précédemment édifiés au Caire et à Zagazig, le projet n’a pas bénéficié du soutien du consulat italien, soucieux d’éviter tout conflit avec l’ordre franciscain. Pour écarter toute controverse, le consulat a alors justifié sa position en affirmant que le cimetière, qualifié d’« international » par ses promoteurs, relevait de la juridiction égyptienne[8].
Un peu plus tard, une autre question devait enflammer les esprits de la colonie. La politique de rapprochement entre les institutions italiennes et les ordres religieux s’est concrétisée en grande partie par le financement des écoles confessionnelles et par le remplacement du personnel laïc par des enseignants religieux. Le projet de confessionnaliser les écoles de la colonie, basé sur les missions franciscaines et salésiennes, a provoqué une vive réaction des associations italiennes séculières ou ouvertement anticléricales. Leur opposition s’est formalisée par la création du Comité de lutte pour les écoles laïques « Pro-Schola », qui, bien que ses résultats aient été limités, est resté actif jusqu’à la fin des années 1910.
C’est dans ce contexte, en contraste ouvert à la fois avec les nouvelles élites de la colonie qui voyaient dans le rapprochement avec l’Église une opportunité pour leurs intérêts, et avec les anciennes élites liées à la tradition du Risorgimento, fidèles à la monarchie et à ses institutions, qu’une nouvelle génération d’« anticléricaux » s’est affirmée autour du journal L’Unione della Democrazia
Comme on le verra par la suite, ce journal a été fondé par un groupe issu de la bourgeoisie intellectuelle laïque et démocratique, souvent inspirée par la libre pensée. Bien que la documentation disponible soit très limitée, l’impact du journal sur la colonie ne semble pas avoir été négligeable, comme le montre l’affaire de la « plaque en l’honneur de Garibaldi », qui a éclaté en février 1908. Le consul d’Alexandrie, le marquis de Soragna, décida d’annuler la cérémonie et d’interdire l’apposition d’une plaque offerte par le sénateur Villari au Collège italien d’Alexandrie, estimant que son texte était offensant pour l’Église et probablement pour la monarchie elle-même. La campagne menée par l’Unione della democrazia a recueilli un tel consensus qu’elle a contraint le ministre Tittoni à rappeler le consul à Rome[9].
Les cercles athées du Caire et d’Alexandrie 1908-1909
La période de 1901 à 1911 correspond en Italie à l’essor de l’« anticléricalisme populaire », ce qui a conduit les consulats italiens en Égypte (mais aussi la police égyptienne) à renforcer la surveillance des éléments anticléricaux sur la base des instructions du ministère de l’Intérieur italien. En parallèle, les années comprises entre 1907 et 1910 marquent une période intense de radicalisation de la lutte anticléricale en Égypte. Bien que les groupes anticléricaux se divisaient sur de nombreux sujets, ils étaient unanimes sur certains points : déplorer l’abandon de la politique laïque du gouvernement et les relations rétablies entre les missionnaires et les institutions de l’État ; s’alarmer des subventions destinées aux écoles religieuses ; défendre leur statut et la nature des programmes scolaires dispensés dans les écoles publiques. Cependant, ce qui inquiétait les autorités italiennes et égyptiennes, c’était la proximité qu’une partie du mouvement radical avait atteinte avec des éléments et des groupes du mouvement anarchiste et socialiste[10].
Lors de la réunion du Caire, selon un rapport de la police, étaient présents certains des militants anarchistes et socialistes italiens les plus actifs de la ville : Brigido Camillo, Vasai Pietro Pietro Vasai, Paraticci Luigi, Azzorini Giuseppe, Dumas Nicola, Camerata et Frassinetti Federico. Le projet allait de pair avec la création d’une salle de lecture avec une bibliothèque adjacente, pour laquelle les présents payaient chacun une cotisation de 15 piastres. La proposition mentionnait également la publication d’un nouveau journal, L’idea, qui vit effectivement le jour en octobre 1909[11]. Au cours de l’été de cette année, le programme et le règlement du Cercle Athée du Caire ont été rédigés. Dans l’introduction, il est écrit :
Les membres du Circolo Ateo ont pour objectif d’étudier, de développer et de propager toutes les vérités démontrées par la science en contradiction avec les principes religieux et déistes, de dissiper tous les préjugés et superstitions imposés par une fausse morale religieuse ; de combattre sans relâche l’obscurantisme dans le but d’éclairer les esprits pervertis par le mensonge. […] Pour mettre en œuvre cette propagande, les moyens imaginés par le Cercle sont : la conférence, la lecture, les promenades historiques sur les lieux où la civilisation moderne et l’histoire, avec leur souffle ineffable de purification, ont effacé toutes les légendes qui peuvent encore laisser des traces[12].
En témoignage du mélange étroit rejoint entre le radicalisme socialiste et la pensée athée et anticléricale en Égypte, une note de l’agence diplomatique italienne du Caire du 2 juillet 1909 indique :
Un certain réveil du parti socialiste et anarchiste du Caire est signalé. Cela est prouvé par la constitution récente du Circolo Ateo, ainsi que la constitution de la Fédération Internationale des ouvriers et employés […]. De plus, un projet de rencontre entre les anarchistes du Caire et d’Alexandrie a été évoqué[13].
Effectivement, le 25 du même mois, une réunion des anarchistes eut lieu dans les locaux du Circolo Ateo dans le but de réunir les diverses factions d’un mouvement profondément enraciné dans le pays, mais extrêmement divisé. Le congrès représenta un pas important dans la tentative – restée inefficace – de « poser les bases d’un accord définitif sur le mouvement anarchiste en Égypte, d’établir une méthode de propagande anarchiste et de coopérer à la publication du journal anarchiste L’Idea »[14]. À propos de ce dernier, il convient de noter que le journal était composé de deux rédactions, l’une au Caire avec Vasai Pietro, Brigido Camillo, Brunello Giovanni et Bambini Umberto, et l’autre à Alexandrie avec les anarchistes Francesco Cini, Ungaretti Costantino, Donato Francesco et Rosenthal Joseph. En outre, souligne la police, le Congrès a également porté sur la « section des Libres Penseurs récemment créée à Alexandrie par Bambini et qui compte déjà 200 membres, promettant de devenir un centre de propagande anarchiste très important »[15].
Il est très probable que le rapport mentionné plus haut ait confondu le Libero Pensiero déjà actif à Alexandrie et le Circolo Ateo. En réalité, la date de fondation de ce dernier reste inconnue, bien qu’il soit certain qu’il existait déjà en 1908. En effet, au cours de cette année, un manifeste célébrant le XX septembre a été publié et affiché dans les rues d’Alexandrie.
Chaque dimanche, écrit une note du consulat, un petit journal intitulé Risorgete [Réveillez-vous], publié en français et en italien, est distribué gratuitement, et contre lequel les plaintes de toutes les communautés religieuses sont fréquentes. Ces plaintes, entre autres raisons, n’ont jamais pu être traitées, car les rédacteurs sont inconnus[16].
S’il n’est pas possible d’attribuer avec certitude ces actions à quelque militant en particulier, l’on peut supposer qu’Umberto Bambini n’était pas totalement étranger à ces événements. On ne sait pas grand-chose de la vie de ce militant, hormis qu’il était fiché comme « anarchiste ». Il est né à Civitanova le 15 octobre 1879 et il est mort à Jesi (Ancône) le 22 novembre 1924. À peine arrivé en Égypte, il est immédiatement placé sous la surveillance de la police qui, le 21 mars 1908, note : « Bambini prononce un discours antimilitariste et antireligieux à la section socialiste d’Alexandrie le 21 mars 1908 »[17]. Son nom apparaît toutefois jusqu’en septembre 1908, date à laquelle, atteint de tuberculose, il quitte le pays pour se rendre à Livourne.
Si Bambini était donc l’une des figures les plus actives du Cercle athée, il existait également à Alexandrie d’autres formations qui se positionnaient sur des positions jugées comme « radicales ». Deux journaux, en particulier, étaient très actifs à cette époque. L’un d’eux, déjà mentionné précédemment, était L’Unione della democrazia, dont l’un des rédacteurs était le poète Giuseppe Ungaretti. Le journal a été défini par le consulat italien comme « l’organe des partis populaires », « subversive parmi les modérés, modérée parmi les subversifs », « résolument anticléricale ». L’autre journal est Risveglio [Réveil] Egiziano, qualifié par le consulat italien comme « anarchiste »[18].
Ce dernier périodique mérite une attention particulière. Il a été fondé en janvier 1908 par l’anarchiste Bambini, qui en était « propriétaire, directeur et rédacteur en chef », et par l’anarchiste Roberto Galliani. Malgré cela, d’après les documents disponibles jusqu’à présent, il semble que le projet n’ait pas réussi à impliquer un grand nombre de militants anarchistes actifs à Alexandrie. Cela semble également être confirmé par un rapport présenté au tribunal consulaire italien d’Alexandrie lors du procès pour « diffamation », qui a concerné le journal en 1909. Lors de l’audience du 20 avril de la même année, l’avocat Giuseppe Turrini, accusé d’avoir écrit un article diffamatoire, déclara que le journal avait eu des difficultés à trouver des collaborateurs et avait donc dû faire appel à des rédacteurs « improvisés »[19].
En ce qui concerne Le Caire, en revanche, le Cercle athée est resté actif jusqu’en 1910. En mai de cette année-là, ses membres étaient toujours à la recherche d’un siège, utilisant des lieux publics tels que la « buvette Casoni », dans la rue Kantaret el-Dikka. Une solution précaire a été trouvée lorsqu’un grand espace fut loué pour accueillir plusieurs ligues ouvrières (Ligue des typographes, Ligue des ouvriers et employés, Ligue des travailleurs du tabac) avec le Cercle athée et le Cercle de la libre pensée[20]. En mai 1910, les élections du nouveau comité du Cercle athée eurent lieu. Une fois de plus, des anarchistes furent élus, dont Vasai et Dumas. À cette occasion, un autre manifeste fut publié en l’honneur du XX septembre.
Le 23 octobre 1910, le Circolo Ateo et le Libero Pensiero du Caire prirent part aux commémorations de l’assassinat de Francisco Ferrer y Guardia organisées par les loges maçonniques. À cet égard, il est utile de retranscrire la description de la manifestation rédigée par le Consul Royal (d’Italie) :
Cependant, les anarchistes ou les anarchoïdes (les membres du Circolo Ateo et du Libero Pensiero), n’ayant pas été invités par les Loges Maçonniques à participer à la commémoration, décidèrent d’organiser leur propre manifestation, de se réunir à l’endroit initialement désigné et interdit par la police, et de former malgré tout le cortège, auquel participeraient également la Ligue des Typographes, les Cigariers, etc. Et cela, non pas spécialement pour faire un acte contre la police, mais pour protester contre les Loges Maçonniques qui ne les avaient pas invités. […] Les manifestants, voyant l’appareil de forces, n’ont même pas tenté de se réunir et se sont dirigés vers le Bar S. Georges, puis se sont rendus au Cimetière Civil, où s’est déroulée sans incident la commémoration pro-Ferrer. Ainsi s’est achevée cette journée qui, à première vue, semblait annoncer de grands événements[21].
Conclusion
Tout comme pour le reste des mouvements de la gauche « radicale » présents en Égypte, le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le démembrement progressif de l’Empire ottoman ont marqué une césure historique très importante. En particulier, la croissance du mouvement nationaliste, culminant avec la révolution de 1919, a eu un impact très profond sur les organisations politiques, syndicales et culturelles agissant dans le pays. Ces dernières, de fait, se « nationalisent » dans un double sens : elles voient une participation croissante de militants égyptiens, et elles sont impliquées dans les luttes nationales et les revendications nationalistes.
Cet élément soulève la question de l’impact des mouvements radicaux, y compris l’anticléricalisme et l’athéisme, qui, bien qu’ils dépassent les bases communautaires, étaient fortement influencés par celles-ci. La réponse à cette question n’est pas simple et renvoie en tout cas à ce qui a été dit dans l’introduction. Il ne fait aucun doute que certains militants égyptiens ont eu des contacts avec les groupes politiques européens avec lesquels ils ont collaboré et ont construit ensemble des fronts de lutte commune. Et pourtant, la situation particulière des Européens, découlant du contexte colonial et du système des Capitulations, a empêché, ou tout au moins rendue plus difficile, une symbiose avec les populations locales. La diffusion de certaines idéologies et pratiques en Égypte ne peut donc pas être considérée comme un simple « produit d’exportation » d’origine européenne. Au contraire, elle résulte de l’interaction entre différents facteurs liés à la convergence de la globalisation des biens, des idées et des personnes avec les spécificités et les traditions issues des contextes locaux.
[1]Financed by the European Union – Next Generation EU, Mission 4 Component 1, CUP J53D23000440006.
[2]Archivio centrale dello Stato (ACS), Direzione Generale Polizia di Stato (DGPS), Circolo Ateo, Cairo, 7 luglio 1909.
[3]Costantino Paonessa, L’anticléricalisme dans l’Égypte coloniale. Le cas de la colonie italienne (1860-1914), Annales islamologiques, 54, 2020, pp. 275-298.
[4]Samuli Schielke, « The Islamic World », in Stephen Bullivant, Michael Ruse (éd.), The Oxford Handbook of Atheism, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 638‑650.
[5]Ilham Khuri-Makdisi, The Eastern Mediterranean and the Making of Global Radicalism, 1860‑1914, University of California Press, Berkeley, 2010.
[6]Ersilio Michel, Esuli Italiani in Egitto, 1815‑1861, Pisa, Domus Mazziniana, 1958.
[7]Costantino Paonessa, « Expériences et enjeux de l’associationnisme et de l’internationalisme en situation coloniale : le cas de l’Égypte (1861-1880) », in Carole Christen, Caroline Fayolle et Samuel Hayat (dir.), S’unir, travailler, résister. Les associations ouvrières au XIXᵉ siècle, Villeneuve d’Ascq, PUS, 2021, pp. 183-200.
[8]Paonessa Costantino, op. cit., 2020.
[9]Ibidem.
[10]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Cairo, 12 agosto 1910.
[11]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Alessandria, 17 agosto 1909.
[12]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Cairo, 3 agosto 1909.
[13]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Cairo, 12 agosto 1910.
[14]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Cairo, 5 settembre 1909.
[15]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Alessandria 10 agosto 1909.
[16]Archivio storico diplomatico Ministero Affari Esteri (ASDMAE), Ambasciata Cairo, b. 120, Cairo, 18 aprile 1909.
[17]ASDMAE, Ambasciata Cairo, b. 111, Cairo, 21 marzo 1908.
[18]ASDMAE, Ambasciata Cairo, b. 120, Alessandria, 18 aprile 1909.
[19]ASDMAE, Tribunale Consolare di Alessandria, Processi Penali, f. 78, 20 aprile 1909.
[20]ACS, DGPS, Circolo Ateo Cairo 1910, Cairo, 25 agosto 1910.
[21]ASDMAE, Ambasciata Cairo, b. 120, Cairo, 23 ottobre 1910.

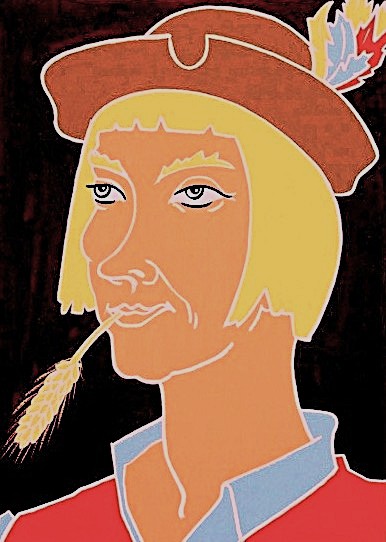


Vous devez être connecté pour commenter.