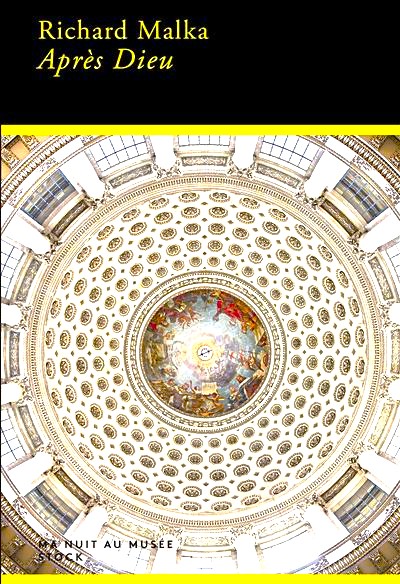
Il n’y a pas d’après Dieu
Patrice Dartevelle
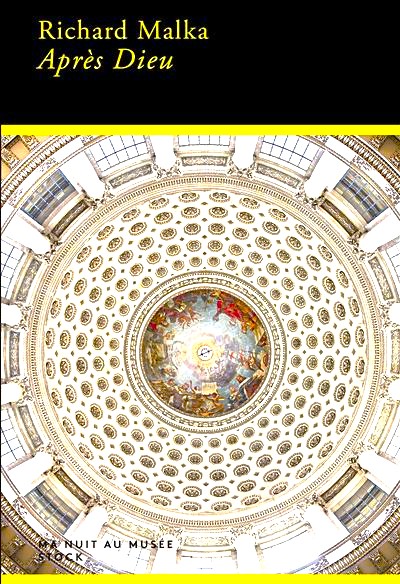
Dans le cadre de sa collection « Ma nuit au musée », les éditions Stock ont obtenu de Richard Malka qu’il participe au projet et à la série où un écrivain passe une nuit au musée et en tire ensuite un livre de son expérience.
L’avocat de Charlie Hebdo, auteur de quelques livres marquants comme Le droit d’emmerder Dieu ou Traité sur l’irrévérence, s’est plié à l’exercice, mais au lieu d’un musée, il a choisi le Panthéon, où il s’est installé près de la tombe où repose Voltaire (mais pas son cœur, confié à la Bibliothèque nationale, ni son cerveau à la Comédie française).
Le livre qu’il en tire, Après Dieu[1], fait preuve d’un beau talent de narrateur, exprime ses craintes devant les empiétements des religions sur la liberté d’expression et tente de résoudre une question trop peu abordée : comment remplacer les religions ?
Le fil conducteur du livre est une interpellation post mortem de Voltaire avec, à un moment de la nuit où Malka s’assoupit, un rêve (qu’il dit authentique, mais juste un peu retravaillé) au cours duquel lui parlent Gambetta, Jaurès, Zola, Victor Hugo et dans le rôle de l’homme d’Église Giovanni Battista Caprara, archevêque de Milan, négociateur pour le Vatican du Concordat entre le Saint-Siège et la France en 1801.
Le retour de la religion
D’emblée, Richard Malka interpelle Voltaire :
Regarde où nous en sommes, toi qui pensais que le fanatisme connaissait ses dernières heures… Regarde François-Marie [Arouet, dit Voltaire] à quel point tu t’es trompé. La promesse de religion citoyenne que vous portiez, toi et cet édifice, a échoué.
Voilà qui amorce les deux thèmes principaux.
Bien sûr, interpeller Voltaire implique le procès du christianisme contre lequel il a tant lutté.
C’est l’époque de la condamnation à mort pour blasphème et de l’exécution en 1766 du Chevalier de la Barre, un jeune homme de vingt ans, accusé d’avoir dégradé un crucifix et de ne pas avoir salué une procession.
Voltaire prend a posteriori sa défense. Il faut dire qu’on avait cloué sur le corps du chevalier avant l’exécution un exemplaire du Dictionnaire philosophique de Voltaire. Mais il s’agit là de la dernière exécution pour blasphème en France.
Par la suite, la Révolution et le régime républicain font reculer l’emprise de la religion, du moins sur l’État, sur l’enseignement jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État en 1905.
Aujourd’hui, cependant, tout a bien changé et la théorie classique des laïques ne convainc plus. Elle distinguait les personnes, qu’il faut respecter, de leurs croyances ou idées qui n’ont droit à nul respect de principe. Et comme le dit Richard Malka : « Je suis désolé, mais si vous êtes blessé par la critique de vos croyances, il faut apprendre à vivre avec ».
Mais aujourd’hui, on voudrait la fin du droit de se moquer de toutes les croyances et « certains obsédés du pas d’offensisme voudraient l’interdire et en faire un droit pénal ».
Il vise l’islamophobie en disant que juifs et chrétiens, eux, se moquent du blasphème. Je n’en suis pas vraiment sûr en ce qui concerne les juifs.
Pour Richard Malka, « L’ennemi de nos libertés est aussi redoutable que masqué. Il se fait appeler respect ».
L’impact de cette aberration sur les jeunes est redoutable :
En enseignant à nos enfants le respect des religions, nous les avons préparés à l’esclavage. C’est un fascinant suicide de la liberté, dicté par une vision de la tolérance dont profite l’intolérance religieuse.
Pire :
Le discours religieux moderne est parvenu à faire croire aux jeunes qu’il existait une liberté non négociable, celle de montrer et d’affirmer sa religion.
Le résultat est effectivement catastrophique.
Richard Malka cite un sondage effectué en France en 2020. Un tiers des 15-17 ans de France interrogés (toutes religions confondues) refusaient de condamner les attentats de 2015 (Charlie Hebdo, Bataclan).
Un tiers, c’est sans doute plus que les seuls interrogés musulmans…
L’islam et l’islamisme
Richard Malka est clair. Le vecteur essentiel du changement, c’est la question des musulmans. Il déclare :
C’est d’abord aux personnes de culture musulmane que je veux m’adresser […] et j’aimerais convaincre chaque intégriste, fondamentaliste, qu’il serait logique que leur créateur n’éprouve pas plus grande joie qu’en voyant ses enfants s’exprimer librement, accéder au libre-arbitre.
Mais les choses ne vont pas ainsi. 76 % des musulmans de France pensent que lorsque religion et science s’opposent, c’est la religion qui a raison, et 78 % pensent que la laïcité est du racisme.
En Angleterre, 32 % des musulmans voudraient imposer la charia à tout le pays[2]. La liste non exhaustive des tués lors d’attentats pour motifs religieux en France depuis 2015 approche les 300 morts.
Richard Malka connaît bien le dilemme : les migrants sont musulmans et aussi des pauvres, des opprimés.
Il dit se casser les dents sur ce double constat. Il pense, fort à la légère, qu’on peut sortir du dilemme entre condamner les terroristes musulmans et être taxé d’islamophobie ou refuser cette condamnation au nom de la considération due aux personnes et être qualifié d’islamo-gauchiste. Il suffirait de condamner l’intolérance et le racisme. C’est un peu un vœu pieux.
Richard Malka est d’accord avec le « pas d’amalgame » qui oblige à distinguer musulman et islamiste, mais le slogan
ne peut obliger de penser l’islamisme, qui serait coupable, comme une doctrine qui n’aurait rien à voir avec l’islam. L’islamisme ne sort pas de nulle part. Ce n’est pas une religion à part.
Pour Malka, « il y a un continuum entre une religion et sa version fanatique… Non seulement, il y a un continuum, mais l’islamisme est en train d’absorber l’islam ».
Il y a là du vrai, mais aussi du faux ou de l’incomplet. L’islamisme relève bien de l’islam et des signes (fréquentation de la prière du vendredi en hausse) montrent que la religiosité des musulmans progresse. Mais le terme « continuum » peut conduire à un leurre. La situation n’a rien de congénital à l’islam. Par rapport au christianisme, il a été plus libre et plus intelligent dans les premiers siècles du second millénaire.
Il s’est étiolé (sauf la fraction turque, du moins jusqu’au XVIIᵉ siècle), sclérosé, sans être bien dangereux.
Ce n’est que depuis 30 ans que les Frères musulmans d’abord, Al Qaïda et Daech ont entamé leur sinistre mission. Il n’y a pas de fatalité inéluctable à ce que cela perdure, même si je reste perplexe quand Richard Malka dit que la solution serait qu’il faudrait un Voltaire en islam.
Faut-il une nouvelle religion ?
À maintes reprises dans son livre, Richard Malka revient sur le vide créé par le retrait de la religion de l’univers du monde occidental (à l’exception des musulmans, je suppose), ce qui ne l’empêche pas de soutenir fanatiquement la loi de 1905 (que je crois datée et particulière à la France) et la loi sur l’interdiction du voile à l’école. Sur ce dernier point, il justifie lapidairement en disant que la religion n’a pas sa place à l’école. Il me paraît facile de répondre qu’au contraire, l’école, pourvu qu’elle soit laïque comme en France dans la très grande majorité des cas, est l’endroit idéal pour apprendre l’existence des autres et accepter leur différence.
Richard Malka durcit le propos célèbre prêté à Malraux en disant que le retour du religieux était inévitable.
Il rappelle que les révolutionnaires français se sont posé la question de la religion et se sont séparés entre les déistes, qui voulaient le culte de l’Être suprême, et les matérialistes, qui se contentaient du culte de la raison.
Voltaire, pour sa part, avait plaidé pour une religion de l’humanité, mais sans succès.
Dans le rêve de Malka, apparaît Victor Hugo pour qui
la littérature est la nouvelle religion à laquelle il faut croire. En réalité, depuis l’essor de la pensée libre, nous cherchons une nouvelle religion, car… ne pas croire est impossible.
Richard Malka est torturé, comme Condorcet, par l’idée qu’abattre la religion – avant que les citoyens n’aient saisi les avantages de la raison – est dangereux. On crée surtout un espace pour les idéologies les plus délirantes.
Mais dans des pays comme ceux d’Europe de l’Ouest et les États-Unis, on est arrivé, depuis plusieurs décennies, à octroyer un diplôme d’enseignement secondaire à 70-80 % de la population et 25 à 30 % des dernières classes d’âge obtiennent un diplôme d’enseignement supérieur. Peut-on imaginer beaucoup plus ? Mieux vaut se demander comment expliquer le contraste entre cette avalanche d’études et la prospérité du royaume de l’irrationnel.
Richard Malka se trompe fondamentalement sur un point essentiel : religion n’implique pas foi.
La foi des chrétiens est spécifique. Elle n’a rien à voir avec des formules telle que « nous croyons au progrès, à la science, à la littérature ou à l’humanité ».
Cette dernière croyance ne peut désigner qu’un état d’affirmation inférieur au savoir. La foi, la croyance des chrétiens, désigne un état supérieur au savoir ou au mieux à côté du savoir[3].
Comment un juif comme Richard Malka peut-il oublier que les juifs – sauf les hassidim, apparus au XVIIIesiècle – ne croient pas ? Ils pratiquent. C’est tout. Faut-il redire la réponse de son professeur de religion juive à Hannah Arendt ? À celle-ci, qui protestait adolescente contre des cours en disant qu’elle n’y croyait pas, le professeur a répondu : qui vous le demande ?
Il ne faut pas « de nouveaux symboles » et une nouvelle religion unificatrice. Elle ne pourrait avoir que les mêmes défauts que celles qui l’ont précédée.
Une religion laïque ? Ce sera bien difficile à faire entendre à la plus grande partie du monde. Songeons aux innombrables exécutions pour blasphèmes, judiciaires ou autres, au Pakistan et au Bangladesh.
La foi, dit Richard Malka, n’est pas synonyme de liberté. Il vise la foi des chrétiens, mais s’illusionne sur la valeur morale plus élevée des non-croyants.
Ils seraient plus altruistes, mais moins généreux dans leurs dons aux associations caritatives. Je ne peux y croire. Il cite une étude réalisée aux États-Unis sur les maltraitances infantiles avec comme variable le degré de religiosité de chaque État. Et le Kentucky, État le plus religieux (c’est celui de J.D. Vance) a un taux de maltraitance quadruple par rapport à l’État le moins religieux, l’Oregon. Mais le Kentucky est aussi l’un des États les plus prieurs (comme le montre J.D. Vance dans le livre qui l’a lancé).
Pourquoi ne pas prendre un autre critère que le religieux ? Non sans impertinence, je suggérerais de prendre le degré de pluviosité : l’Oregon est l’État le plus pluvieux et aussi le plus athée. Il a même eu autrefois un gouverneur ouvertement athée, situation plus que rare aux États-Unis.
Il ne faut pas une autre « transcendance ». À mon sens, il faut s’habituer à vivre sans transcendance. Pour un matérialiste, toutes celles imaginées sont de pures inventions humaines qui ne peuvent unir tous les peuples, tous les citoyens.
Pour moi, la démocratie véritable n’est pas séparable d’un débat permanent. Je ne crains rien tant que la morne et fictive unanimité.
Aucun sacré ne peut exister.
Curieusement, pour Richard Malka non plus. Dans une interview, on lui demande : « Finalement, qu’y a-t-il de sacré pour l’athée que vous êtes ? ». Il répond : « Rien… sauf ma mère, bien sûr ! » [4].
Ouf…
[1] Richard Malka, Après Dieu, Paris, Éditions Stock, 2025, 213 p.
[2] Pas plus ici que plus haut, Richard Malka ne renvoie à ses sources.
[3] J’ai expliqué cela dans mon article « Foi, religion, croyance : de quoi parle-t-on ? » in Pourquoi croit-on en Dieu ?, P. Dartevelle (dir), Bruxelles, ABA Editions, Bruxelles, 2023, pp 11-23 ainsi que dans mon autre article « Plutarque ou quand l’athéisme vaut mieux que la superstition », Newsletter N°44 de l’Association Belge des Athées, postée sur athées.net le 2 mai 2024 (à paraître dans L’Athée N°12-2015), passim.
[4] Interview par Raphaëlle Bacqué, Le Monde des 2-3 février 2025.

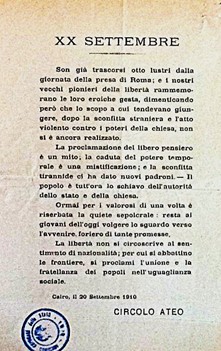
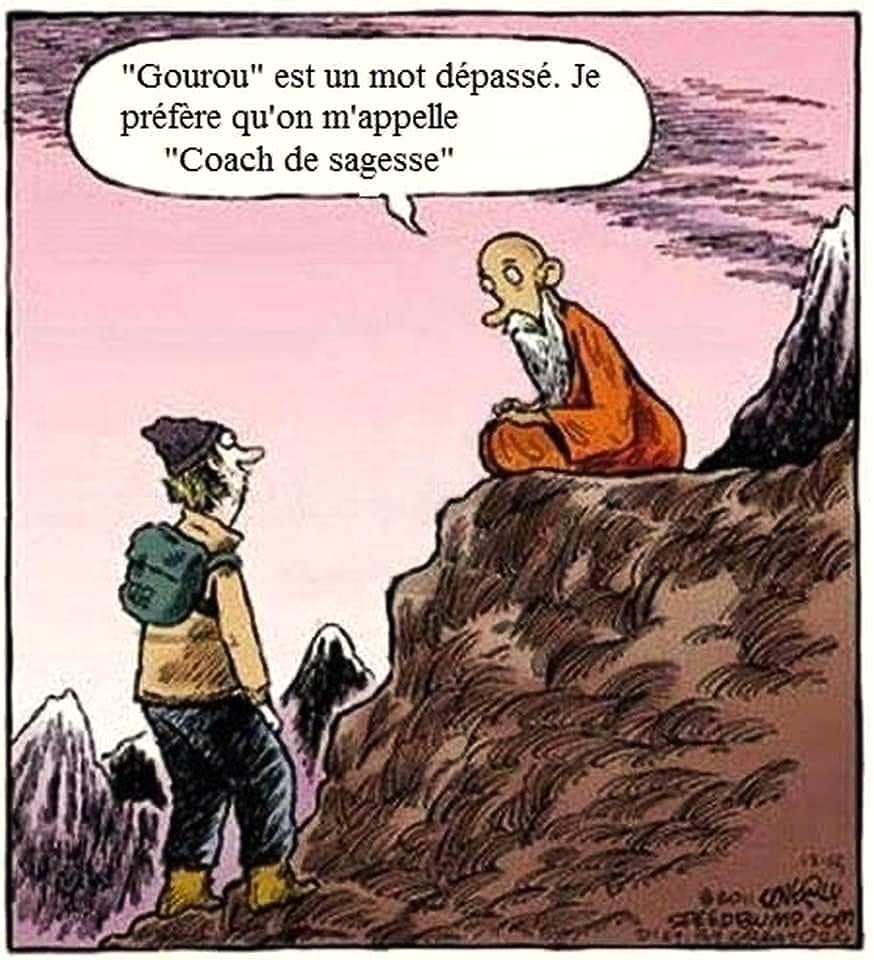
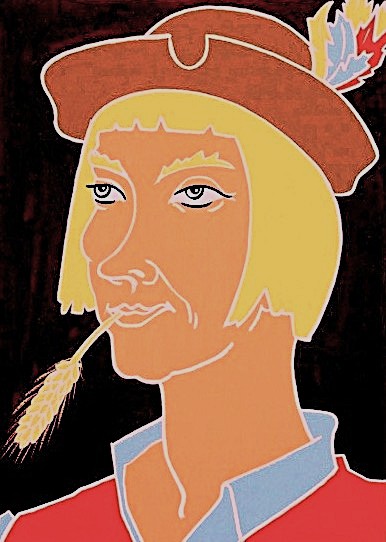
Vous devez être connecté pour commenter.