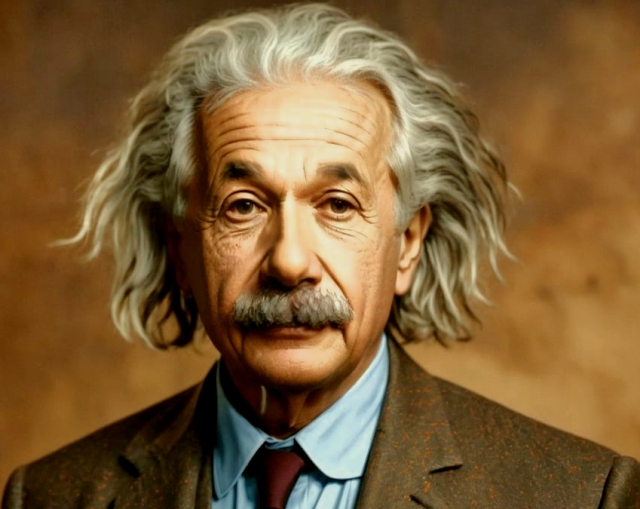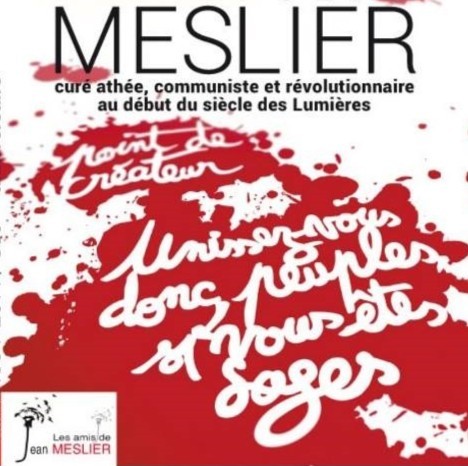La Confession romaine de Giordano Bruno
Marco Valdo M.I.
Dans cette Confession romaine, comme dans les précédentes entrevues fictives [1], un Inquisiteur tente de cerner l’athéisme de l’impétrant ; c’est le métier d’Inquisiteur de faire parler les suspectes et les suspects d’hérésie ou pire – « Parlez, parlez, nous avons les moyens de vous faire parler »[2]. On trouve face à l’enquêteur Juste Pape, le suspect Giordano Bruno, surnommé le Nolano – en français le Nolain –, né dans le sud de l’actuelle Italie, à Nola en 1548 et mort à Rome en 1600, accusé formellement d’athéisme et d’hérésie, condamné et brûlé vif au terme de huit années de procès. Pour constituer son dossier, l’Inquisiteur se réfère aux écrits de Giordano Bruno et aux dossiers secrets de l’Inquisition romaine.
Bonjour, Monsieur Filippo Bruno, dit Giordano Bruno. Je suis Juste Pape, enquêteur de l’Ovraar [3] en mission spéciale. Je voudrais tout d’abord m’assurer que vous êtes bien Filippo Bruno, dit Giordano Bruno, né en janvier 1548 à Nola en Italie et mort le 17 février 1600 à Rome, frère dominicain et philosophe.
Je vous salue, Monsieur l’Inquisiteur, je suis bien celui que vous dites. Cependant, je préfère que vous m’appeliez Giordano Bruno, nom sous lequel j’ai fait connaître mes idées et sous lequel je suis connu du monde entier depuis ma mort sur le bûcher de la place du Campo de’ Fiori à Rome. J’espère que vous avez abandonné vos méthodes barbares et brutales d’interrogation, car vous pouvez me croire sur ce point, je déteste ces manières moyenâgeuses. Même si à présent, je me fous de vos extravagances, car de toute façon, elles ne pourraient plus rien contre moi et dès lors, je veux juste dénoncer ces iniquités honteuses qu’on m’a fait subir pendant des années.
Rassurez-vous, Monsieur Bruno, nous y avons renoncé depuis longtemps et même, à présent, nous les dénonçons quand nous les savons pratiquées par d’autres, peu importe qu’ils le fassent au nom de leur religion ou de leur pouvoir dictatorial ou des deux à la fois ; il en va de même pour les exécutions capitales. Cela étant précisé, pouvez-vous me dire d’où vient ce surnom de Giordano, dont je ne comprends pas pourquoi vous l’avez préféré à Filippo, que votre père avait choisi et qui vous avait été donné au baptême et de ce fait, consacré par Dieu ?
Oh, Monsieur l’Inquisiteur, ce n’était pas là une marque d’irréligion. Bien au contraire, je n’ai pas renié le nom de Filippo, mais Giordano est devenu mon nom de plume et d’autre part, je l’avais choisi également comme mon nom de frère dominicain, car c’était le prénom de mon professeur de métaphysique, Giordano Crispo, dont j’étais très admiratif et à qui je voulais ainsi rendre hommage. Comme vous le savez certainement, j’ai fait des études au couvent dominicain des Frères Prêcheurs de San Domenico Maggiore à Naples, études que j’ai poursuivies jusqu’à mon ordination. Remarquez que ce couvent est celui où Thomas d’Aquin, lui-même dominicain, enseigna et finit ses jours. J’ai d’ailleurs soutenu ma thèse de docteur en théologie à son sujet.
Parlez-moi de votre famille et de votre jeunesse. Enfant, vous avez dû aller à l’école.
La famille dont je suis issu n’était pas des plus pauvres, ni des plus riches. Ma famille n’était pas non plus une famille de paysans. On vivait dans les environs de Nola, petite cité située entre Naples et Avellino, au pied du Mont Cicala. Mon père – Giovanni Bruno – exerçait le métier d’homme d’armes ; c’était une sorte de mercenaire, sous-officier dans l’armée du Roi d’Espagne, dont le Royaume de Naples est une possession, et comme vous l’imaginez aisément, avec ce métier de nomade, mon père n’était que rarement à la maison. C’est donc ma mère, Fraulissa Savolino, qui disposait des revenus de quelques terres, qui assura principalement ma première éducation ; c’était une femme pieuse et très soucieuse de m’assurer un avenir. Elle me fit suivre les premières classes à l’école du village ; c’était un enseignement élémentaire, mais sérieusement développé. J’avais comme ami le Mont Cicala, qui dominait notre village et la région ; dans le lointain, fermant le paysage, on pouvait voir le Vésuve, l’autre mont de mes horizons. Le Cicala était luxuriant de végétation et vu de là où je vivais, le Vésuve apparaissait terne ; c’était une grosse éminence grise qui striait le ciel. J’aimais l’un et je craignais l’autre que je n’appréciais vraiment pas. Quand un peu plus tard, je m’en fus à Naples, je m’aperçus de mon erreur. Le Vésuve était semblable au Cicala ; mes yeux me trompaient. Ainsi, ces deux amis m’enseignèrent à douter de l’évidence. J’en ai tiré ceci pour la vie, et pour ma philosophie, que c’était seulement en s’approchant des choses que ce qui ne se voyait pas venait finalement au regard et que pouvait émerger la vérité. En toute matière, il convenait d’y regarder de plus près. Cela avait comme conséquence que soit on trouvait des réalités inattendues, soit on découvrait le rien. Je n’ai jamais perdu cette exigence de vue ; elle a guidé mon existence.
Poursuivons, dit l’Inquisiteur. Après ces premières écoles, vous êtes entré au couvent pour y faire des études religieuses.
Ensuite donc, je m’en fus à Naples poursuivre des études d’humanité – très exactement « à apprendre les lettres d’humanité, de logique et de dialectique » – jusqu’à quatorze ans, avant d’entrer au couvent de San Domenico in Napoli où, à quinze ans, je pris « l’habit de Saint Dominique » ; je suis donc devenu un dominicain. Une nécessité, si l’on voulait poursuivre des études. J’ai suivi la carrière ecclésiastique pendant onze ans : ordonné prêtre en 1572, et docteur en théologie en 1575. C’était la plus solide formation religieuse qu’on pouvait avoir, mais, si on savait lire, écrire, réfléchir, discuter, disputer et si on était comme moi, assoiffé de savoir, sur le côté, on pouvait s’informer d’autres pensées et de façon extrêmement vaste. Ainsi, j’ai pris durant des années connaissance des Écritures, des auteurs grecs et latins, des docteurs du Moyen Âge, des philosophes arabes, des néoplatoniciens, des cabalistes, des naturalistes, des alchimistes, des astronomes. Et pensez donc, j’en ai eu le temps, j’y ai passé onze années. Ce furent des années de formation, de recherche et d’édification de ma conscience, fondée sur un immense appétit de savoir, une connaissance en continuelle expansion, une irrépressible interrogation du monde, une réflexion permanente et une conviction d’être moi-même le maître de mon savoir, nourri à de multiples sources hétérogènes. J’admirais cet éclectisme cohérent du savoir qu’avait développé, trois siècles auparavant, le poète, philosophe, théologien et prêcheur catalan, Raymond Lulle[4]. J’avais aussi, dans mes pérégrinations dans la ville de Naples, trouvé des livres d’auteurs plus contemporains et plus ou moins, interdits ; je songe tout particulièrement à Érasme, dont je m’inspirai tout au long de mon existence.
Je vois, dit l’Inquisiteur, et cela n’a pas dû passer inaperçu aux yeux de l’institution.
Mes écarts furent vite repérés ; à commencer par mes intempérances vis-à-vis du culte de Marie et des Saints ; puis, mes doutes sur la Trinité. Tout ça faisait désordre et allait à l’encontre, et même mettait en péril, la rigueur doctrinale imposée par l’habit ecclésiastique. Il s’agissait de faire de moi un frère prêcheur, chargé de porter dans le monde la vraie croyance et de combattre l’hérésie. À l’exemple du fondateur de l’ordre, il était question, comme le chantera une sœur dominicaine, d’aller pauvre en tous chemins, en tous lieux, ne parler que du Bon Dieu. Souvenez-vous :
Dominique, nique, nique
S’en allait tout simplement,
Routier, pauvre et chantant
En tous chemins, en tous lieux,
Il ne parle que du Bon Dieu,
Il ne parle que du Bon Dieu.[5]
Notez que Dominique de Guzman, depuis sanctifié Saint Dominique, marchait dans les pas des croisés, qui massacraient les Albigeois, les Cathares, les Vaudois. Par la suite, ses successeurs, devenus inquisiteurs, en firent autant des protestants. Toujours est-il qu’en 1576, au couvent, on montait contre moi un procès en m’accusant d’avoir défendu publiquement des écrits hérétiques ; je craignais une condamnation pour hérésie et je m’enfuis à Rome. Là, on m’accusa du meurtre d’un frère et je me défroquai pour fuir à nouveau en un long vagabondage dans le nord de l’Italie : Gênes, Noli, Savone, Turin, Venise – d’où la peste me chassa – et puis, Padoue, Bergame où j’ai repris l’habit. Ensuite, je m’en fus de l’autre côté des Alpes, à Chambéry, puis à Genève où j’abandonnai encore mon habit dominicain et je ralliai le protestantisme. Ainsi, j’avais laissé là l’Italie pour éviter les calomnies des inquisiteurs, qui sont ignorants et ne comprenant rien à ma philosophie, m’accusaient d’hérésie.
Savez-vous, demande l’Inquisiteur, pourquoi vous vous êtes écarté ainsi de l’enseignement de vos maîtres et que vous avez enfreint la règle de votre ordre ?
Ce sont l’audace et la liberté de penser et cette irrévérence qui m’ont poussé toute ma vie à aller de l’avant, à tracer mon chemin et à développer mes considérations philosophiques. En fait, j’avais le plus grand et le plus impérieux désir de voir les coutumes du monde, de connaître les esprits, de découvrir, si possible, une nouvelle vérité, de confirmer mon habitude de la connaissance, de prendre conscience de ce quelque chose qui toujours me manquait. Plus j’en connaissais, plus je voyais ce que je ne connaissais pas, plus je voulais en connaître.
Mais quand même, dit l’Inquisiteur, vous avez été ordonné prêtre, vous aviez prêté serment à Dieu, vous aviez reçu mission de Lui d’être frère prêcheur…
C’est exact, Monsieur l’Inquisiteur, mais frère prêcheur, finalement, je l’ai été toute ma vie et même un prêcheur performant. La seule chose – et c’est ce qui m’a valu mon destin tragique et le bûcher sur le Champ des Fleurs à Rome – fut que je ne prêchais pas les dogmes de l’Église, ni Dieu lui-même, mais les convictions que je me formais au fur et à mesure de l’extension de mon champ de savoir et de connaissances. Telle était mon attitude de vie et mon premier moteur de pensée, d’autant que mon mental se répandait baignant tout de cette conception matérialiste de la réalité, de l’unité de la nature. Je résume : toute la matière est vie et la vie est dans la matière, une matière infinie et toujours changeante ; il n’existe rien en dehors de la matière. J’étais déjà imbibé de cette tenace irréligiosité qui rendait impossible, il me faut bien le reconnaître, mon séjour au couvent et irrémédiablement, dans l’Église. Par la suite, j’ai souvent essayé de me réconcilier avec la foi catholique, de me rapprocher et même de rentrer dans l’Église, mais c’était vraiment inconciliable.
Soit, dit l’Inquisiteur, on en était à Genève et à votre ralliement à la Réforme dans la version calviniste. Vous n’êtes pas resté là-bas ; pourquoi ? Et puis ?
À Genève, j’ai jeté mon habit aux orties et je me suis rallié à la Réforme, croyant y trouver un havre de liberté de penser et de parole. Mal m’en a pris, je me suis heurté à la rigidité et à l’intransigeance des calvinistes ; j’ai été arrêté et contraint à me rétracter. Ainsi, j’ai expérimenté que les religions se ressemblent en ceci qu’elles sont intolérantes et dogmatiques. Elles ne peuvent se faire à la pensée errante et libre, audacieuse, chercheuse et soucieuse d’exactitude, qui se confronte toujours avec l’inconnu et avec le doute. Bref, on était en 1579 ; je me suis rendu compte que je ne pouvais rester là sans danger, je suis reparti et je me suis rendu à Toulouse où je me suis diplômé maître en arts et j’ai été lecteur en philosophie. Mais j’avais la bougeotte et deux ans plus tard, je m’en fus à Paris où, assez admiratif d’un Henri III, roi de France, cultivé, généreux, pacifiste et libéral, fils de Catherine de Médicis, qui s’entourait d’intellectuels et d’artistes italiens et de cette cour de Valois où, dans cette ambiance de guerre de religions, se mêlaient les « modérés » catholiques et protestants face aux gens de la Ligue, celle-là même dont on trouve trace dans la chanson de Georges Brassens intitulée « Oncle Archibald »[6]. Si vous ne la connaissez pas, « Oncle Archibald » est cette chanson où en son introït, Brassens chantait un hymne proprement décapant, libérateur, dénonciateur, anticlérical et sans aucun doute, athée, en désignant ainsi la cléricaillerie et son avidité :
Ô vous, les arracheurs de dents,
Tous les cafards, les charlatans,
Les prophètes,
Comptez plus sur oncle Archibald
Pour payer les violons du bal
À vos fêtes.
et pour en revenir au Roi Henri III et à la Ligue, dirigée par le fanatique Duc de Guise :
Tu pourras crier : « Vive le roi ! »
Sans intrigue ;
Si l’envie te prend de changer,
Tu pourras crier sans danger :
« Vive la Ligue ! »
C’est à cette période parisienne que j’écrivis divers traités et mon premier grand texte littéraire qu’est la comédie, forcément napolitaine, « Le Chandelier »[7], dans laquelle je développai une féroce condamnation de la stupidité, de l’avarice et de la pédanterie. À Paris, je passai ainsi deux ans, le Roi m’ayant institué « lecteur royal ».
Passons, dit l’Inquisiteur, que vous est-il arrivé ensuite, comment se poursuivit votre cavale ?
Monsieur l’Inquisiteur, je préfère le mot exil qui reflète mieux mon parcours à travers l’Europe. J’ai donc quitté Paris et la Sorbonne, où j’avais quelques démêlés et je me suis rendu en Angleterre, où je passai quelque temps à Oxford à débattre avec les tenants de l’aristotélisme et de l’anglicanisme ; là aussi, je me heurtai aux tenants du passé et aux dogmatismes religieux et philosophiques. Je laissai l’université et je rejoignis Londres où je trouvai à m’employer auprès de l’ambassadeur de France, Michel de Castelnau. C’est là que je fis connaissance avec le courant anglais moderniste et progressiste, qui s’ancrait autour de la cour de la Reine Élisabeth. J’y croisai nombre d’intellectuels et d’hommes de culture, très au courant des dernières évolutions du monde, parmi lesquels John Florio, fils d’exilé italien, traducteur des Essais de Montaigne et à présent de plus en plus considéré comme l’auteur de l’œuvre publiée sous le nom de William Shakespeare[8]. C’est dans ces années londoniennes que j’éditai, en 1584, les dialogues italiens où je développai ma cosmologie qui allait au-delà de celle de Copernic et la métaphysique à la base de mes réflexions ; comme la réputation m’en a été faite depuis, je me considère comme un inventeur de philosophies nouvelles, comme un explorateur de l’imaginaire.[9]
Et ensuite, Monsieur Bruno, vous avez quitté l’Angleterre ; quelles furent les étapes suivantes ?
Je rentrai en France à la suite de l’ambassadeur Castelnau et je professai mes conceptions à Paris, mais la crise politique et religieuse qui sévissait et le manque de soutien de la cour, m’amenèrent à quitter à nouveau le sol français. Je m’en fus alors en Allemagne chercher à m’employer comme professeur dans les universités et je trouvai une chaire à celle de Wittenberg, où je fus accueilli par les luthériens ; puis je fus, une fois encore, excommunié et rejeté en raison de divergences philosophiques. À nouveau, l’intolérance eut raison de mon ralliement de bonne foi à la religion locale. Ce qui me conduisit à Prague, à la cour de l’Empereur, lequel me récompensa d’une belle somme d’argent ; ensuite, je m’en allai à Tubingen et à Helmstedt, toujours à la recherche d’une cathèdre.
Ainsi, Monsieur Bruno, vous êtes parvenu à recueillir les excommunications des grandes confessions européennes, catholique, calviniste et luthérienne. Mais poursuivez l’histoire de votre périple.
Donc, ensuite, je suis allé à Marbourg, après un passage par Zurich, un retour à Francfort et finalement, je m’en allai à Venise. De retour en Italie, j’ai espéré trouver à l’Université de Padoue une chaire de mathématique. Ce ne fut pas le cas et je rentrai à Venise, où je commis l’erreur insigne de me mettre sous la coupe d’un patricien, qui me dénonça à l’Inquisition. C’est ainsi que commença mon séjour dans les prisons de l’Église. J’avais presque réussi à me dépêtrer de la poursuite de l’Inquisition vénitienne, quand l’Inquisition romaine prit le relais jusqu’au bout. Cette agonie dura huit ans et après de nombreuses tergiversations, l’Église me proposa de me renier, d’abjurer les fondements de ma philosophie sous peine de me confier au bras séculier, c’est-à-dire qu’elle me menaçait directement de la peine de mort. Comme vous le savez, j’ai refusé tout net et je leur ai dit que je n’avais rien à me reprocher étant philosophe. Comme tel, je désire la compagnie de ceux qui commandent de ne pas fermer les yeux, mais de les ouvrir. Je n’aime pas dissimuler la vérité que je vois, et je n’ai pas peur de la professer. Pour bien signifier mon refus et ma conviction profonde, quand ils m’ont présenté sur le bûcher les réconforts religieux et le crucifix, je tournai la tête avec mépris.
Finalement, Monsieur Bruno, comment vous définiriez-vous ? demande l’Inquisiteur.
Selon un portrait que je fis de moi à l’époque, disons : une physionomie perdue comme en contemplation, ennuyé et bizarre, ne me contentant de rien, timide comme un vieillard de quatre-vingts ans, aussi fantastique qu’un chien qui a reçu mille écus, nourri d’oignons. Je suis en fait indifférent à toutes les confessions religieuses et tant que l’adhésion à une religion ne porte pas préjudice à mes convictions philosophiques et à ma liberté de les professer, je serai catholique en Italie, calviniste en Suisse, anglican en Angleterre et luthérien en Allemagne. Comprenez que je n’ai jamais été religieux que par opportunisme et qu’à mes yeux, même si in fine, je disais que Dieu se confondait avec la nature elle-même, seule la nature unique et autonome est de tous temps. Lors de mon passage à Oxford et à Londres, les Anglais l’avaient déjà bien perçu qui m’avaient qualifié d’athée. Et dans le fond, ils n’avaient pas tort.
Ainsi donc, je vous signalerai comme athée. Au fait, quel souvenir gardez-vous de votre exécution ? demande l’Inquisiteur.
Le 17 février 1600, la langue dans la bouche – serrée par un bâillon pour m’empêcher de parler –, j’ai été emmené sur le Campo de’ Fiori. Là, on m’a dénudé, attaché à un poteau et brûlé vif. Ils ont jeté mes cendres dans le Tibre. Ce dernier geste m’a fait plaisir, car je rejoignais ainsi la nature par un des plus beaux chemins ; j’allai vers la mer et le grand air, moi, qui avais été enterré vivant dans leurs cellules sombres. Torturé méchamment et brûlé vif sur le Campo de’ Fiori en l’an 1600, mourant, j’ai emboîté le pas de la belle qui ne me semblait pas si féroce (en tout cas moins que vos inquisiteurs…) et nous sommes partis, elle et moi, bras dessus bras dessous, je ne sais où, faire nos noces qui furent fabuleuses et durent encore. Ne vous en déplaise !
[1] Carlo Levi, Raoul Vaneigem, Clovis Trouille, Isaac Asimov, Jean-Sébastien Bach, Bernardino Telesio, Mark Twain, Satan, Savinien Cyrano de Bergerac, Michel Bakounine, Dario Fo, Hypatie, Cami, Dieu le Père, Émilie du Châtelet, Percy Byssche Shelley, James Morrow, Denis Diderot,Louise Michel, Jean Meslier, Alexandre Zinoviev, Edgar Morin, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Terry Pratchett, Marie Curie, Charles Darwin, Jésus.
[2] Francis Blanche, in Babette s’en va-t-en guerre (1959).
[3] OVRAAR : voir note dans Carlo Levi
[4] Raymond Lulle (en catalan : Ramon Llull ; en latin : Raimundus ou Raymundus Lullus ; en arabe : رامون لول), né vers 1232 à Palma de Majorque et mort en 1315 est un philosophe, poète, alchimiste, théologien, missionnaire, apologète chrétien et romancier majorquin. Il est l’auteur d’une œuvre touffue et complexe, de surcroît rédigée en plusieurs langues (latin, catalan, arabe).]
[5] Sœur Sourire, Dominique, Philips, 1962. Pour rappel, Sœur Sourire est celle que les Étazuniens surnommèrent The Sourire singing nun – la Nonne chantante (une cousine du Père Duval que Brassens appelait « La calotte chantante ») ; on lira sa biographie assez tourmentée, révoltée et dramatique qui s’interrompt brusquement au bout du mois de mars 1985 en un double suicide commun de Sœur Sourire, redevenue Jeanine Deckers et de sa compagne, Annie Pécher. Voir la notice Wikipedia Sœur Sourire.
[6] Georges Brassens, Oncle Archibald, Philips, 1957.
[7] Giordano Bruno, Candelaio – Chandelier, 1582, Paris. Voir in Œuvres Complètes (Collection bilingue dirigée par Yves Hersant et Nuccio Ordine et publiée sous le patronage de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici et du Centro internazionale di Studi Bruniani « Giovanni Aquilecchia »), publiées en de multiples volumes en traduction française, aux Belles Lettres, Paris, à partir de 2000.
[8] À ce propos, on lira avec intérêt de Lamberto Tassinari, John Florio, alias Shakespeare, Éditions du Bord de l’Eau, Bordeaux, 2016, 380 p.
[9] Giordano Bruno, il s’agit notamment des trois dialogues : Cena delle Ceneri, Della causa, principio e uno, De l’infinito, universo e mondi, auxquels il convient d’adjoindre Lo spaccio de la bestia trionfante et De gli eroici furori (1585). Voir Œuvres complètes, op. cit.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.