
Le postmodernisme à l’assaut des Lumières
Patrice Dartevelle
Superficiellement, du moins je le crains, l’hommage aux Lumières reste de rigueur. L’ex-président Obama y fait une fois de plus référence dans une interview donnée à l’occasion de la publication du premier tome de de ses Mémoires présidentiels tout en insistant sur le sens que le terme peut avoir après quatre années de « trumpisme ». Pour lui, il est essentiel de « développer une pensée critique et de comprendre qu’il existe bien des vérités objectives, misant sur les valeurs héritées des Lumières associées à la logique et à la raison, aux faits et à l’objectivité, à la confirmation des hypothèses »[1].
Dans son combat contre les attaques terroristes et pour les libertés « républicaines », E. Macron dit aussi : « … ce ne sera pas la réinvention des Lumières, mais il va falloir défendre les Lumières contre l’obscurantisme »[2].
Le responsable de la rubrique Culture dans le journal Le Monde, Michel Guerrin, après l’assassinat de Samuel Paty, voit bien clairement l’isolement des partisans de la liberté d’expression et conclut : « Le verrou qui tiendra le système ou le fera exploser, à l’école comme dans l’art, s’appelle philosophie des Lumières… elle sert aujourd’hui à défendre la liberté de parole et d’art partout dans le monde »[3] et un mois plus tard, il ne peut que recueillir les propos alarmés d’une professeure de lettres qui dit : « La philosophie des Lumières, jadis en majesté dans les manuels, n’a cessé d’y perdre du terrain »[4]. C’est un bon exemple des risques que l’on prend en réduisant à une simple façade l’enseignement des lettres et de l’histoire.
Voici peu d’années, j’avais abordé la question de l’actualité et de la pertinence des Lumières dans ces mêmes colonnes, en me concentrant sur le retour du religieux, le progrès et les limites de la science en m’attachant à confronter les idées des Lumières aux éléments contemporains. J’y relevais notamment, après bien d’autres, l’hostilité montante à l’égard de la science[5].
Stéphanie Roza, chargée de recherches au CNRS, spécialiste des Lumières, reprend tout autrement le problème dans son ouvrage La gauche contre les Lumières ?[6].
Son problème est une question centrale de ce qui est changé dans le débat depuis quelques décennies : une large fraction de la gauche politique, non contente de ne plus s’en référer aux Lumières, les désigne comme la source de tous les maux (nazisme et camps d’extermination compris)[7].
L’irrationalisme
L’attaque initiale venant d’un irrationalisme de gauche émane de deux leaders d’un important mouvement politique de tradition marxiste, l’École de Francfort, Théodore Adorno et Max Horkheimer, qui publient en 1944 (avec une reprise en 1947) Dialektik der Aufklärung, texte traduit en français en 1974 sous le titre Dialectique de la raison. Avant ce livre, estime à juste titre S. Roza, on chercherait en vain un penseur de gauche qui ne se réclame pas de la raison.
Adorno et Horkheimer attribuent clairement à la raison la responsabilité des catastrophes contemporaines. Pour eux, les Lumières se sont détruites elles-mêmes, elles sont responsables des résurgences de l’irrationalisme. Elles sont « totalitaires ». Adorno et Horkheimer étaient pourtant parmi les mieux placés pour savoir combien les nazis haïssaient les Lumières.
Leur point d’attaque le plus sérieux vient du constat qu’ils font qu’on ne peut déduire aucune obligation morale de la raison seule – ce qui contient une part de vérité – et donc que la morale des Lumières porte en elle la possibilité des crimes les plus terribles – ce qui est faux. Ils liquident ainsi intégralement le rationalisme et se mettent à suivre les auteurs les plus classiques de la réaction intellectuelle.
À partir de 1945, Heidegger va continuer sa critique de la technique et de la modernité entreprise avant la guerre, comme il se doit vu son engagement en faveur du nazisme.
Comme l’explique E. Faye, auteur d’un ouvrage critique sur Heidegger et que suit S. Roza, le but de Heidegger est « de faire croire, pour se disculper, à un retournement dans un rapport au national-socialisme et charger, non les guides du nazisme mais l’ensemble de la tradition philosophique occidentale de l’industrie d’anéantissement du IIIe Reich ». S. Roza ne cache pas sa perplexité devant le vrai problème : la réception de pareilles idées par les intellectuels français et notamment la réception de Heidegger par Sartre, Derrida, Deleuze voire Badiou et Agamben.
Le cas le plus marqué est celui de Michel Foucault. Celui-ci a parfois varié en politique et dans sa relation aux Lumières mais pour l’essentiel ses propos sont clairs quand on les parcourt : « en français, la torture, c’est la raison », « l’autonomie de structure (de la raison) porte avec soi l’histoire du dogmatisme et du despotisme ». Et c’est parfois pire et plus absurde. Voici de quoi convaincre du caractère gratuit et sans fondement des formules de Foucault, comme le relève Stéphanie Roza : « Le socialisme a été d’entrée de jeu, au XIXe siècle, un racisme. Avant l’affaire Dreyfus, tous les socialistes, enfin les socialistes dans leur extrême majorité, étaient fondamentalement racistes ». C’est de la pure fantaisie. En France comme en Belgique, seuls quelques socialistes par exemple étaient antisémites (en Belgique, le juriste Edmond Picard et deux ou trois épigones).
La ligne directrice de Foucault est connue. Il est le héraut d’une critique permanente de tout (il n’est pas forcément inacceptable d’être hypercritique) et d’une dénonciation de tout pouvoir, assimilé à la prison. Pour lui, tout est enfermement (les hôpitaux psychiatriques en premier puisque la raison n’existe pas pour lui ou est le pire de tous les maux). Son maître-mot est la résistance au pouvoir, à tout pouvoir (aveu de l’incapacité à le modifier et plus encore à le prendre ?), à toute normativité, à tout discours construit. Dès lors, à la participation aux luttes sociales classiques pour le pouvoir politique et économique, il préfère la lutte pour la fermeture des hôpitaux psychiatriques et dans le domaine des relations sexuelles (comme la reconnaissance de l’homosexualité). Ce n’est pas toujours absolument blâmable mais cela crée insidieusement une politique non plus générale mais particulière. Cela correspond bien en fait à l’émergence des nouveaux thèmes politiques, spécialement à gauche, des dernières décennies, en prenant forcément un peu ou pas mal de la place aux autres.
S. Roza ne peut voir au nom de quoi, de quels critères ou fondements, M. Foucault établit ses exclusives, ses choix. En réalité, Foucault est hostile à une construction philosophique ou politique globale, structurée, qui ipso facto, créerait une forme de pouvoir…
Il ne peut ou ne veut rien changer dans la société. En 1984, il dit que les tentatives de transformations sociales à visée universelle mènent directement à l’horreur totalitaire. Selon lui, à la différence de ce qu’y voient les rationalistes, l’étude des Lumières aboutit à mettre en relief le caractère essentiellement contingent de l’aspiration à une vérité. On voit poindre derrière de telles idées la contestation du caractère universel des droits de l’homme, ce qu’il dit explicitement à Chomsky en 1971, rappelle S. Roza : « Vous ne pouvez m’empêcher de croire que ces notions de nature humaine, de justice, de réalisation de l’espèce humaine sont des notions et des concepts qui ont été formés à l’intérieur de notre civilisation ».
Le rapport de Foucault aux Lumières est complexe et contradictoire. Il reprend au fond d’une certaine manière le rôle politique critique des philosophes du XVIIIe siècle, mais finit par se séparer d’elles au nom de leur pratique critique en niant la possibilité de toute critique rationnelle. C’est intellectuellement intenable.
Reste un problème. Foucault a obtenu la plus haute charge universitaire française, celle de professeur au Collège de France. Comment a-t-on pu être aussi aveugle ?
L’anti-progressisme
J’ai traité assez longuement la question du progrès et de l’idéologie du progrès dans mon article de 2017-2018 déjà cité pour simplement ajouter et commenter quelques éléments mis en exergue par Stéphanie Roza. Elle utilise notamment pour cette partie de son étude les textes d’un collectif de Grenoble « Pièces et main d’œuvre » et spécialement ceux d’un de ses membres qu’elle nous dépeint comme plus modéré que bien d’autres.
Bertrand Louant ne renie pas vraiment les Lumières. Il les loue comme une pensée en lutte à son époque contre l’ignorance et la superstition, mais il dénonce le scientisme qui aurait supplanté l’ancienne conception au XIXe siècle et aurait fait de la science une religion et plus encore de la « techno-science » après 1945. Le scientisme comme impérialisme de la science sur l’ensemble des domaines humains est certain, mais il a produit une volonté de développer la science qui ne peut être négative. Plus largement même, il ne faut pas voir par exemple l’art comme réduit à une pure subjectivité. Il utilise des techniques nouvelles notamment dans les arts graphiques. Ainsi en 1896, à la fin de sa vie, Félicien Rops écrit-il : « Il faut avant tout, en art, littérature, ou peinture, et même en musique que chaque fragment de production soit un avéré progrès… Sans cela on est en perte ».
Mais Louant ne semble pas entendre grand-chose à la science. Pour lui, le darwinisme ne tient pas debout parce qu’il n’est qu’« une pure projection idéologique de la structure de la société anglaise sur le règne animal et végétal ». On voit le funeste enchaînement des raisonnements. Louant se moque de savoir si Darwin dit vrai (Louant y connaît-il quelque chose ?). La vérité n’est pas son problème, la nature ne peut être que belle et égalitaire et peut-être belle parce qu’égalitaire. La nature est sa religion.
L’autre argument, c’est l’identification fréquente – quasi de règle dans le milieu irrationaliste – entre la technologie et parfois la science et un capitalisme qu’il faut abattre quel qu’en soit le prix.
Tout le mal serait le fait du développement technologique, cause véritable des guerres. C’est la soif de savoir d’Einstein et des physiciens qui a conduit à la bombe atomique. L’idéologie nazie, le nationalisme, les causes religieuses (la Byzance des VIIe-VIIIe siècles connaît même de rares violences sur la seule question des icônes, sans qu’on puisse trouver un autre motif), idéologiques ou géopolitiques n’existent pas pour Louant. Le poids des arguments d’Einstein à Roosevelt dans sa lettre de 1939 pour se mettre à l’abri d’une toute-puissance nazie ne l’impressionne-t-il pas ? Einstein avait-il le pouvoir d’allouer l’énorme budget nécessaire ?
Ces néo-luddites refusent de reconnaître ou même d’espérer un progrès quelconque. Comme si la vie d’aujourd’hui n’était pas meilleure qu’avant la révolution industrielle ! Maintenant un Belge lambda voit la médecine guérir sans problème un mal dont aucun médecin de son temps n’a pu soulager Louis XIV. S. Roza leur concède tout au plus – à juste titre selon moi – que les hommes des Lumières ont été naïfs ou trop optimistes en ayant confiance que les sociétés humaines feraient bon usage du progrès scientifique et technique.
Le résultat de telles inepties est particulièrement catastrophique aujourd’hui. Elles sont la source principale et la justification des adversaires de la vaccination.
S. Roza s’en prend à un cas plus mélangé, celui de Jean-Claude Michéa, qui se veut de gauche. Dans son ouvrage Le complexe d’Orphée, publié en 2004, Michéa rejette « l’idéologie du progrès parce qu’elle est inséparable de la foi libérale et capitaliste ». Critiquer le libéralisme est certes parfaitement concevable, mais quand l’anti-libéralisme devient une religion, on n’aboutit qu’au dogmatisme et au mépris du réel.
Michéa s’en prend aussi aux droits de l’homme, qu’il voit comme une pression illégitime à l’unification du genre humain, sans prendre en compte que les droits de l’homme sont supérieurs aux vieilles traditions. Celles-ci sont la seule issue si l’on refuse progrès et droits de l’homme. Même aux mains d’un libertaire, le conservatisme n’est pas sans risque.
L’anti-universalisme
La question de l’universalisme ou plutôt de l’anti-universalisme est sans doute la plus présente dans le débat public. Toute la question de l’antiracisme, du féminisme, du décolonialisme engendre des débats plus qu’animés, à défaut de n’être pas souvent productifs. La discussion porte spécialement et notamment sur l’intersectionnalité ou du féminisme intersectionnel, du cumul de discriminations comme être femme et noire. De pareils cas existent forcément en grand nombre et on peut étudier les effets spécifiques du cumul de « handicaps ». Mais certains protagonistes de ce thème imaginent un lien de consubstantialité entre ces éléments et en font le moteur de toutes les discriminations, selon un mode de raisonnement de type : la colonisation et l’oppression de la femme se joignent pour fonder une idéologie nationale raciste.
On met en cause même les mouvements antiracistes et féministes « traditionnels » parce qu’ils sont l’œuvre de Blancs qui agissent au nom d’un idéal de droits universels. Dès lors, les droits de l’homme sont une invention mal intentionnée des Blancs et des Blanches. On parle alors de « trahison » du féminisme occidental.
En étudiant les personnes et les groupes porteurs de ces thèmes, Stéphanie Roza estime n’avoir trouvé qu’un grand vide d’argumentation.
Ainsi, en analysant un des textes fondateurs de ce mouvement, celui de Kimberlé Cresham de 1991, elle en montre l’absurdité. K. Cresham s’y borne à étudier deux groupes de femmes qui vivent dans un refuge aux États-Unis, l’un de femmes noires, l’autre de femmes asiatiques. Tous deux se sentent opprimés pour des raisons différentes que Cresham unifient sous l’étiquette de femmes non-blanches en dénonçant des réglementations adaptées aux femmes blanches sans jamais voir que la caractéristique qui réunit toutes ces femmes est d’être pauvres. K. Cresham, elle, conclut : « La race et le genre sont parmi les tout premiers facteurs responsables de cette distribution particulière des ressources sociales qui aboutissent aux différences de classe observables ». Il y a en plus dans ces raisonnements un défaut que l’on observe fréquemment, la prévalence du seul cas des Noirs américains. Mais comment appliquer pareille théorie dans les poches de pauvreté que sont bien des villages pauvres du centre de la France ? Cresham escamote intégralement l’oppression de classe et ne peut y voir ni un moteur important ni l’oppression de base. Dans la pratique, K. Cresham réclame une « politique identitaire », pensée par et pour les Noirs faisant fi des différences sociales entre Noirs, entre femmes.
Dans les combats autour d’un thème annexe, celui de la décolonisation, les représentants de cette tendance mettent en cause les responsables des pays du tiers-monde qui se situent dans la ligne de l’universalisme. S. Roza se fait un plaisir de citer plusieurs textes de leaders du tiers-monde qu’il est impossible ou pas si simple de traiter en laquais de l’Occident. Elle utilise plusieurs textes importants d’Hô-chi-Minh, qui, en 1921 comme en 1945, en réfère constamment à la Déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776 et à la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de la Révolution française de 1791. Loin d’y rejeter l’homme blanc, il veut soutenir les ouvriers français opprimés par le patronat, une fois le Vietnam libéré de cette emprise. S. Roza cite aussi Nehru, qui adhère au rationalisme et à la science : « Je suis convaincu que ce sont les méthodes de la science qui, plus que tout, ont révolutionné l’existence humaine ». La malignité de la référence vient de ce qu’en s’exprimant de la sorte, Nehru s’oppose à Gandhi, qui veut tout le contraire : une régénérescence des traditions des valeurs et du passé indiens.
S. Roza traite également sous l’angle de l’anti-universalisme d’un des intellectuels les plus importants de la critique post-coloniale, Talal Asad. Celui-ci a enseigné l’anthropologie à l’Université John Hopkins. C’est une personnalité considérable. Il est membre du Comité de la recherche économique et sociale en Angleterre et du Conseil de la recherche en sciences sociales aux États-Unis. J’ai déjà cité brièvement sa théorie de la religion, en la désignant comme ayant souvent recueilli l’assentiment des spécialistes du domaine[8].
Outre qu’il n’a jamais dissimulé son hostilité à Rushdie, il a publié en 2003 un livre dirigé contre le sécularisme et les droits de l’homme, un autre en 2007 visant à « déconstruire », comme on le dit dans ce monde, les préjugés des Occidentaux à l’encontre des terroristes (il était pourtant basé à New-York) et un troisième, avec Judith Butler, sur l’affaire des caricatures danoises de Mahomet, pour légitimer la dénonciation du blasphème. En 2015, quelques jours après l’attentat contre Charlie Hebdo, il donne une interview dans laquelle il remet en cause le caractère sacré (c’est un terme que je ne ferai cependant pas mien non plus) de la liberté d’expression.
Comme anthropologue, partant de l’idée que l’on définit la religion sur base du seul moule du christianisme – une opinion exacte pour le passé, mais périmée depuis plusieurs générations – et spécialement sur celle du luthéranisme, qui centre la religion sur la foi intime, il oppose l’islam à cette vision de la religion.
À la différence du christianisme, l’islam, qu’Asad présente toujours comme un bloc homogène, doté seulement de quelques traîtres, est fondé sur un rapport aux textes sacrés vus comme une autorité pour le croyant dans ses faits et gestes. Le chrétien, en revanche, cherche à connaître Dieu et à avoir une relation avec lui tandis que pour un musulman, la foi, ce sont fondamentalement des actes, expose Asad.
Dans un ouvrage récent traitant du fanatisme, le dominicain Adrien Candiard corrobore cette vision du moins dans les limites d’une des grandes écoles théologiques de l’islam, le hanbalisme et du représentant de cette école au XIVe siècle Ibn Tamiyya. Le hanbalisme postule en effet que l’homme ne peut connaître Dieu, mais uniquement l’expression de sa volonté, c’est-à-dire ses ordres, donc le Coran[9].
Sur ces bases, on ne peut que poser deux blocs irréductibles à jamais, l’islam et le christianisme. On notera qu’Ibn Tamiyya est connu comme l’inspirateur du GIA algérien, qui s’en est servi pour justifier l’assassinat de chrétiens et d’agents de l’État algérien.
Plus sophistiqué et plus contemporain dans son expression, Asad voit dans la gouvernance libérale (l’occidentale) une technique de consensus dont le sécularisme est le moyen. Mais selon lui, ce n’est que le masque de la coercition. Je croyais pourtant que le sécularisme était fondé sur la liberté d’exprimer ses convictions personnelles dans les limites de celles des autres… Asad nous narre tout un roman historique pour étayer sa thèse. Le problème des Occidentaux serait les guerres de religion du XVIe siècle. Selon Asad, le sécularisme a permis, en calmant ces guerres, de les remplacer par les guerres coloniales et nationales (je ne sais pas où il met le second conflit mondial). Chose extravagante, il ne fournit aucun texte historique qui puisse étayer pareille idée. Ici encore, la vérité ne compte pas ou elle est laissée aux tâcherons de l’histoire.
Et donc en clair, le sécularisme serait la source réelle de la colonisation. Il n’est pas le seul à soutenir cette position, notamment en France, sous prétexte que le grand républicain laïque Jules Ferry a dit dans un discours que la France répandait dans ses colonies les idéaux républicains. Mais Clemenceau, qui n’était pas moins républicain et laïque, était anticolonialiste au nom des mêmes idéaux. En plus, cet argument ne pourrait valoir, comme rétorque S. Roza, que pour la colonisation française et en aucun cas pour l’anglaise, l’allemande ou la portugaise. J’ajouterais que le cas du Congo belge (auquel Asad ne pense pas, ses dossiers d’arguments sont toujours tronqués ou vides) est pire encore : la colonie belge a été intégralement phagocytée par les missions chrétiennes, avec une atténuation à partir de 1954 seulement. Sans doute pour Asad, les États-Unis sont-ils le paradigme de la colonisation du fait des guerres de 2001 et 2003, mais confondre celles-ci avec la colonisation historique est pour le moins approximatif et de toute manière, les États-Unis ont toujours dénoncé le colonialisme des Européens au nom de leur tradition d’un pays lui-même autrefois colonisé.
Pour couronner le tout, Asad qui, il est vrai, en réfère sur ce point à Hanna Arendt, les droits de l’homme dépendent exclusivement des législations nationales et donc « l’État a le droit de se servir du discours des droits de l’homme pour contraindre ses propres citoyens de même que les pouvoirs coloniaux avaient le pouvoir d’utiliser ce discours contre leurs propres sujets ». Quant aux États musulmans, ils peuvent n’en avoir que faire. Je retiens toutefois le mot « discours » : l’influence de Foucault n’y est-elle pas pour quelque chose ?
Perplexités
On peut suivre Stéphanie Roza quand elle écrit : « Nous estimons avoir trouvé d’importantes raisons de la débâcle idéologique dans le devenir de la pensée critique au cours de la deuxième moitié du XXe siècle ». Certes, bien des changements sociaux, politiques, religieux, etc. ont eu lieu dans cette période, mais elle a raison de mettre l’accent sur le rôle du postmodernisme dans la défaite du rationalisme.
Mais on reste au milieu du chemin. Comment et pourquoi tant d’intellectuels français d’après 1945 ont-ils fait de Heidegger leur idole ? Si la lutte contre le capitalisme était le motif de beaucoup, il est difficile de prendre Heidegger pour un anticapitaliste, mais il était hostile aux sciences et à la technologie. Capitalisme et science ne sont pas deux mots pour dire la même chose, affirmation sans base que certains dont je viens de parler nous assènent sans cesse. Et puis Sartre n’était point si sot. Quant à l’audience dont Michel Foucault a bénéficié, elle ne me semble pas plus explicable.
Stéphanie Roza lie tout cela au retrait de la gauche, entendue à peu près au sens traditionnel incluant le rationalisme, partie de son livre que mon texte minimise. Sur cet aspect, je lui poserais bien une question.
Le mot « gauche » peut-il encore apporter de la clarté ? S. Roza ne voit-elle pas que les critères qui faisaient que quelqu’un était de gauche il y a trente ou quarante ans et ceux qu’on emploie aujourd’hui n’ont plus tant de points communs ? Et que les irrationalistes qu’elle dénonce ont pris le dessus et confisqué le terme. Le souci de la nature était de droite et celui de la liberté d’expression de gauche. Tout est inversé. Pour ma part, j’aime mieux la clarté.
Notes
- Interview par Javier Moreno, publiée initialement dans El Pais, reprise dans Le Soir du 20 novembre 2020 sous le titre « Trump a causé beaucoup de torts aux États-Unis et dans le monde ». ↑
- Propos tenus le 16 novembre 2020 dans un entretien accordé à la revue Le Grand Continent, passage repris dans Le Monde du 18 novembre 2020. ↑
- Michel Guerrin, « Enseignants et artistes, même combat », Le Monde du 24 octobre 2020. ↑
- Michel Guerrin, « À l’école de la liberté d’expression », Le Monde du 21 novembre 2020. ↑
- Patrice Dartevelle, « L’héritage des Lumières. Une succession après inventaire », mis en ligne sur www.athee.info le 16 juillet 2017, texte dans L’Athée, n°5 (2018), pp. 81-101. ↑
- Stéphanie Roza, La gauche contre les Lumières, Paris, Fayard, 2020, 203 p. ↑
- Sur ce sujet, on lira aussi la contribution de Jean Bricmont, « L’école de Francfort, la dialectique contre les Lumières » in Le grand bazar de l’irrationnel, Bruxelles, ABA Éditions, 2020, pp. 105-128. ↑
- Patrice Dartevelle, « De la religion au-delà de Saint-Germain-des-Prés », mis en ligne sur www.athees.net le 24 avril 2020, texte dans L’Athée, n°6 (2019), pp. 49-66, spécialement p. 51. ↑
- Adrien Candiard, Du fanatisme. Quand la religion est malade, Paris, Les Éditions du Cerf, 2020. ↑


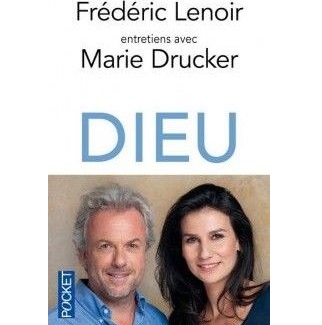

Vous devez être connecté pour commenter.