L’effacement des vestiges yiddish sous l’édification nationale israélienne par Pierre Gillis
Tout le monde s’accordera vraisemblablement pour reconnaître la complexité des couches de critères superposés qui balisent et structurent notre identité. Il faut dire que le monde où nous essayons de nous situer cultive le paradoxe : alors qu’un rouleau compresseur marchand aplanit les histoires et les cultures pour faire place nette aux séries télé américaines et aux superproductions hollywoodiennes, le politiquement correct nous incite simultanément à nous raccrocher à nos particularités communautaires, sans lesquelles nous perdrions notre âme, dit-on.
Il se fait que je me sens personnellement concerné par la constitution d’une de ces identités, d’autant plus que je la considère comme problématique : peut-on se dire juif sans se revendiquer d’une appartenance religieuse ?
De fait, la réponse à cette question est positive : de manière différente, le CCLJ (centre communautaire laïc juif, « sioniste de gauche ») et l’UPJB (Union des progressistes juifs de Belgique, anti-sioniste) se réclament d’un tel positionnement. Ce fait n’épuise toutefois pas le sujet : on peut bien sûr éprouver de l’empathie pour celles et ceux qui assument leurs racines au-delà de leurs origines religieuses, mais la cohérence de cette attitude n’en est pas établie automatiquement pour autant.
Première précision, cependant, en guise de déblayage initial : identité non religieuse, certes, mais bien évidemment, aussi éloignée des élucubrations racistes, du genre « un juif se reconnaît au premier coup d’œil », on n’échappe pas à sa race. Je ne ferai à personne l’injure de consacrer davantage de lignes à le convaincre qu’il n’y a pas de race juive – nez crochu, cerveau apte aux abstractions, et dieu sait quelles autres fadaises. La génétique n’a rien à faire dans ce débat, ce dont il est question, c’est de culture, et de symbolique nationale.
La judéité comme essence éternelle
L’historien israélien Shlomo Sand a pris cette question à bras-le-corps, d’abord en consacrant une importante partie de sa vie professionnelle, de sa vie de chercheur, à l’examen critique des légendes qui brouillent cette problématique. Il a montré « Comment le peuple juif fut inventé » par le mouvement sioniste (Paris, éditions Fayard, 2008), dans un ouvrage qui pulvérise la fiction d’une histoire linéaire, celle d’un peuple-race qu’une errance cyclique aurait conduit de la Terre promise perdue à la Terre promise regagnée, via une très longue marche qui ferait de celle des communistes chinois une promenade de santé. Si un peuple juif a existé, c’est celui qui habitait le Yiddishland – l’unité des communautés sépharades étant principalement religieuse. Un vieil ami, aujourd’hui décédé, avançait la position iconoclaste que le peuple juif a été liquidé en deux temps, d’abord par Hitler, avec le génocide, et ensuite par l’État d’Israël, qui a détruit ce qui restait de la culture du Yiddishland. On y reviendra, en soulignant évidemment l’incommensurabilité des deux responsabilités.
Mon attention a dès lors été immédiatement attirée par l’annonce de la parution d’un essai du même Shlomo Sand, au titre inattendu : Comment j’ai cessé d’être juif. Inattendu, parce que s’il y a bien une idée reçue qui cadenasse la discussion, c’est celle qui veut qu’on est juif ou qu’on ne l’est pas. Bon sens élémentaire : une chaise ne cesse pas d’être une chaise, un chien ne devient pas un chat, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages !
Ce cliché, qui a la force de l’évidence, constitue un trait marquant de l’antisémitisme traditionnel, et encore plus de l’antisémitisme paroxystique des nazis. Que ce gène de l’antisémitisme ait acquis le statut d’un lieu commun oblige à un triste constat, celui qui enregistre une aussi insupportable victoire ! Mais simultanément, on comprend dans la foulée que la question creusée ici ne peut trouver de réponse satisfaisante que si elle est discutée comme un cas particulier de définition d’un peuple, ou de construction nationale. On peut débattre de l’existence d’un peuple juif, et décider, le cas échéant, de s’en revendiquer – ou pas. On peut aussi changer de nationalité.
Former nation : quel critère ?
L’idée de nation révèle immédiatement une forte tension, une réelle contradiction, entre la généalogie qui la fonde comme allant de soi, à partir d’une histoire plus ou moins poreuse à l’imagination collective, d’une part, et la volonté d’autonomie qui agglomère ce qui forme alors une collectivité politique assumée, de l’autre. La langue, une histoire commune, une oppression partagée ou une domination exercée de concert peuvent déboucher sur l’émergence d’un sentiment national, mais sans qu’aucune règle ne fixe à l`avance la stœchiométrie de la réaction qui est susceptible de produire l’effet attendu – à savoir l’agglomération d’une communauté politique. On parle d’ailleurs de volonté d’autonomie, de volonté de former nation : la subjectivité de la formule crève les yeux – et même s’il est sans doute possible de préciser quelques-unes des conditions dont l’absence empêcherait la mayonnaise de prendre et la nation de se constituer, il faut aussi entériner l’échec irrémédiable, et vraisemblablement définitif, de tous ceux qui se sont risqués à une tentative de définition exhaustive, qui aurait permis de jauger « de l’extérieur » la légitimité des prétentions de groupes ethniques, culturels ou linguistiques, en souffrance de reconnaissance, à former nation. Cette subjectivité foncière transparaît aussi dans l’usage du « nous » pour se situer au sein des rapports politiques : « nous » n’est pas un autre, c’est la seule chose qu’on puisse en dire.
La contradiction visée ici, entre généalogie et revendication d’autonomie, oppose le passé et le futur, dans la mesure où le second n’est pas seulement l’extrapolation du premier, son prolongement inéluctable : le passé, c’est l’histoire du groupe, le futur, c’est son projet. Il arrive – pas si rarement que ça – que le développement du projet s’appuie sur une manipulation de l’histoire.
La constitution d’une nation a aussi bien des choses à voir avec la formation d’un État, et avec la quête de légitimité qui conditionne son installation. L’État et la nation, c’est un peu comme l’œuf et la poule, en tout cas en Europe et depuis deux siècles : on n’arrêtera plus de se disputer pour savoir si l’État crée la nation en mobilisant toutes ses énergies pour convaincre ses sujets de son existence, ou si l’irrésistible force du sentiment national entraîne ceux qu’elle rassemble à incarner ce sentiment dans une construction longue, ambitieuse, conflictuelle et souvent violente, celle d’un État… Seules les faciles évidences du bon sens naturel tranchent la question sans hésiter, les États étant, par nature, datés, localisés, imparfaits, alors que les nations sont éternelles, toujours au-dessus de l’idée qu’on s’en fait et de notre monde sublunaire : les États seraient les réalisations approximatives de l’essence-nation, promise de tout temps à sortir de son cocon et à prendre enfin son envol étatique.
Retour à mon sujet, en commençant par le passé et l’Histoire. Je peux me permettre d’être expéditif à ce propos, en m’appuyant sur les résultats de Shlomo Sand, et sur sa démonstration d’une invention du peuple juif. À la fin du XIXe siècle – c’est le moment où naît le sionisme –, quatre-vingts pour cent des juifs du monde et leurs descendants laïcs, soit plus de sept millions de personnes, vivaient dans l’empire russe, dans la Galicie austro-hongroise, et en Roumanie. Cette concentration, incongrue si on les confronte aux sources bibliques et qu’on est tenté de prendre celles-ci au sérieux, est la conséquence de l’existence, du Xe au XIIe siècle, de l’ancien empire Khazar-juif, dans les steppes de la Russie méridionale, et des pratiques prosélytes du judaïsme de l’époque. On peut à juste titre parler de situation semi-nationale, pour les juifs d’Europe de l’Est : communauté de langue (le yiddish), culture spécifique basée sur le « shtetl », la bourgade juive, habitudes alimentaires et vestimentaires… Semi-nationale, dans la mesure où cette promesse n’a pas pris corps, comme l’histoire contemporaine nous le montre. Nous avons appris à éclater de rire quand on évoque nos ancêtres les Gaulois, mais le lien qui nous relie à eux est malgré tout un peu moins évanescent que celui qui relierait les communautés du Yiddishland et les douze tribus bibliques légendaires qui habitaient la Galilée, la Judée et la Samarie dans l’Antiquité. À la même époque, le XIXe, les juifs sépharades, surtout ceux du Maghreb, partageaient les cultures locales des populations arabophones et musulmanes, de sorte que leur différenciation à l’égard de ces dernières était de nature purement religieuse.
L’anéantissement de la Yiddishkeit
Tous les États élaborent certes une mythologie pour sacraliser leur existence, mais rares sont ceux pour lesquels la béance entre ces mythes et les acquis des recherches historiques est aussi vertigineuse qu’à propos d’Israël. Oublions donc les références bibliques, qui constituent un véritable trompe-l’œil, et venons-en à un héritage moins fantaisiste, celui des juifs d’Europe centrale.
Promesse non tenue, ai-je écrit plus haut. En effet : les années 1880, première étape du début de la fin pour la Yiddishkeit, ont vu déferler une vague de pogroms, concomitante de la montée des nationalismes ethnocentrés dans l’empire russe – polonais, ukrainien, letton, lituanien. Ces pogroms donnèrent lieu à un important mouvement d’immigration vers l’Occident, Europe et Amérique. C’est de cette période que date le cliché relevé plus haut : auparavant, les juifs pouvaient se sauver par l’« assimilation », en montrant patte blanche, au prix de leur conversion et de la répudiation de leur foi, en manifestant une très ostensible bonne volonté. À partir de ce moment, on cesse de tourner autour du pot : un juif, c’est un juif, et ce ne sera jamais un vrai Français, ou un authentique Teuton aryen, pas plus qu’un pieux Polonais.
L’étape suivante est malheureusement bien connue, et décisive : le nazisme est de loin le principal responsable de l’anéantissement du Yiddishland, du génocide par balles à celui des chambres à gaz. Nul besoin d’épiloguer !
Le volontarisme de la construction étatique israélienne
La création de l’État d’Israël intervient, chacun le sait, immédiatement après cette immense tragédie. On aurait pu imaginer qu’elle représente un virage à 180° par rapport à la disparition de la culture juive d’Europe centrale. Erreur : dès l’immédiat après-guerre, il s’est agi de construire une nouvelle identité, et cette construction n’a été possible que par la négation des antécédents yiddish de bien des nouveaux bâtisseurs. Pas de confusion : si un sentiment national yiddish a existé, débouchant sur une idéologie semi-nationale, non religieuse et territoriale, ce fut le fait du Bund, le parti social-démocrate juif dans l’empire russe, au début du XXe siècle, et pas celui du sionisme.
Le juif nouveau ne pouvait être celui de l’exil, pas plus qu’il ne pouvait être réduit à l’image des malheureuses victimes des nazis. L’armée et l’école ont pleinement joué leur rôle d’appareil idéologique d’État, en façonnant le sabra, dont l’image tourne résolument le dos à celle de l’artisan ou de l’intellectuel juif européen, victime récurrente de persécutions.
Le rejet des patronymes typiques de l’exil est révélateur de la même volonté : Grün s’est fait appeler Ben Gourion, Szymon Perski est devenu Shimon Peres, les parents de Barak s’appelaient Brog, et Ariel Sharon a voulu éviter qu’on l’appelle Scheinermann.
En 1949, le Parlement israélien vota une loi qui réservait le montage de spectacles en yiddish à des troupes étrangères, à l’exclusion des nationaux, à qui cela était interdit.
Shlomo Sand rapporte une anecdote révélatrice, qui confirme cette tendance lourde par le petit bout de la lorgnette : « En 1971, je réussis à me faire accepter comme étudiant titulaire à l’université de Tel-Aviv. Mes connaissances en anglais étant insuffisantes, je fus obligé de suivre une session de perfectionnement. Au premier cours, […] le professeur demanda à chaque étudiant d’indiquer sur une feuille les langues qu’il maîtrisait en plus de l’hébreu. Au début du cours suivant, il interrogea : qui est Shlomo Sand ? Je levai le doigt, craignant de voir se répéter le cauchemar que j’avais connu au lycée avant d’en être expulsé. Mais il en alla différemment : ‘Sand est le seul à avoir mentionné le yiddish ; qui d’autre parle yiddish dans cette classe ?’ Neuf bras se levèrent. Ainsi, au début des années 1970, nombreux étaient encore ceux qui n’osaient pas avouer qu’ils parlaient la langue misérable de ‘l’exil’ ».
La lutte contre la langue de l’exil prit fin une fois la victoire de l’hébreu assurée, et l’identité nationale israélienne incontestée, soit dans les années 1970. Aujourd’hui, il faut se rendre à New York, où Cholom Aleikhem et Isaac Bashevis Singer, immenses écrivains yiddish, ont terminé leur vie, ou à Paris, pour entendre parler yiddish. La conclusion est sans appel : une culture populaire a été anéantie, sans espoir de retour.
Dans le cas israélien, la querelle de priorité évoquée plus haut – de la nation vers l’État ou de l’État vers la nation – trouve une réponse indiscutable : c’est une politique d’État volontariste et autoritaire qui a créé la nation – et cette nation est israélienne, la référence juive étant bien sûr omniprésente, mais problématique, au sens où elle est à la source de problèmes insolubles dans un cadre moderne, laïc et démocratique. Et plus le temps passe, plus le partage d’une domination, à l’encontre des Palestiniens et des Arabes, devient la pierre de touche de l’identité nationale – un peu comme la fierté d’être à la tête d’un empire consolidait l’appartenance british, il en reste d’ailleurs quelque chose, alors même que l’empire britannique a disparu. Comme l’écrit Shlomo Sand, « en Israël, être ‘juif’, c’est avant tout ne pas être Arabe », remarque qui prend tout son sens en pensant aux cohortes d’arrivants récents en provenance de l’ex-URSS, dont la judéité est souvent… légère.
Pierre Gillis

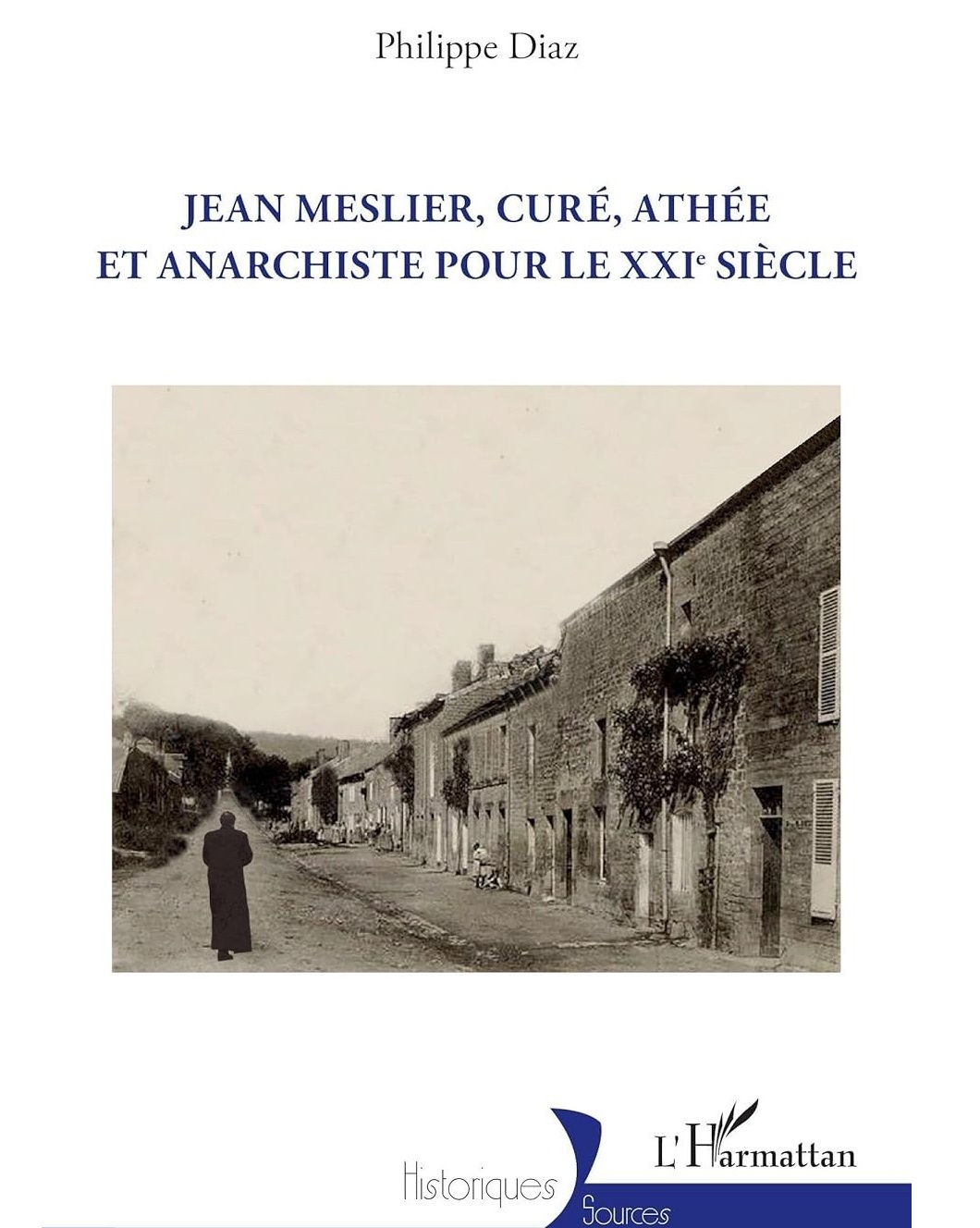

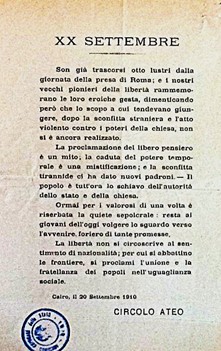
Vous devez être connecté pour commenter.