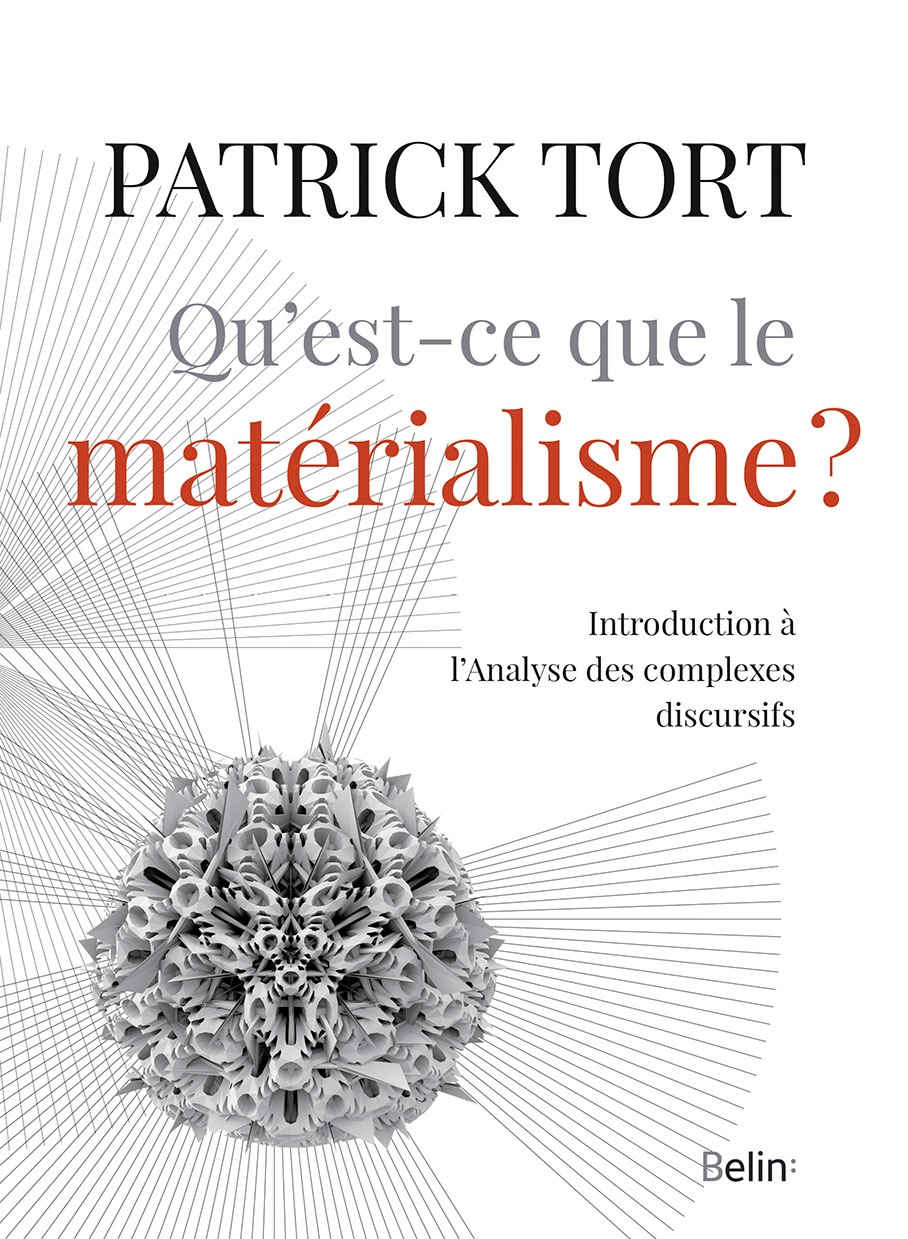
Merci à Patrick Tort : il a raison
Aucun scientifique rigoureux ne contestera le fait que la vie soit une possibilité réalisée de la matière – matière qu’il devient dès lors absurde de considérer comme essentiellement ou primitivement non vivante.
La thèse mise en exergue risque de désarçonner le lecteur accroché par le titre du livre de Patrick Tort (Qu’est-ce que le matérialisme ?) : elle a des relents vitalistes, qu’on rattache d’ordinaire plutôt à l’idéalisme. Ceci mérite bien un petit examen…
Commençons par nous réjouir d’un constat, que Patrick Tort dresse pour nous :
Si la « prémodernité » peut être décrite comme l’état au sein duquel la science, sous peine de condamnation, devait encore s’adapter à la théologie, la « modernité » peut en revanche se définir comme l’état au sein duquel la théologie, sous peine de discrédit, doit, de plus en plus, s’adapter à la science[1].
Pour qui en douterait, il suffit de noter que l’évolution n’est plus dénoncée en tant que telle, ou que l’historisation physique de l’univers ne provoque plus d’urticaire. Les théologiens modernes n’ont pas, pour autant, entamé une mue matérialiste. La règle de conduite de leur côté, c’est le NOMA, Non Overlapping Magisteria, du paléontologue Stephen Jay Gould. Jean-Paul II déclarait ainsi en 1981 à un groupe de prix Nobel :
La foi et la science appartiennent à deux ordres différents de connaissance qui ne peuvent se superposer l’un à l’autre.
Passons sur l’usage désinvolte du terme « connaissance » pour qualifier les deux domaines d’activité intellectuelle, pour retenir la bonne nouvelle que notre constat traduit : la ligne de démarcation entre les deux domaines s’est déplacée, et le territoire placé sous la juridiction des sciences s’étend. Mais le NOMA, même sous sa version pragmatique d’agreement politique entre gens de bonne compagnie[2], n’a de sens que si le tracé d’une frontière bénéficie d’un consensus, voire d’un traité en bonne et due forme. Alors, où se situe la nouvelle ligne Maginot ?
Jean-Paul II a clairement désigné la nouvelle ligne de défense, en 1996, en s’adressant aux membres de l’Académie pontificale des Sciences : c’est le principe immatériel de l’âme sur lequel il n’est pas question de reculer, le compromis n’est pas à l’ordre du jour.
Les théories de l’évolution qui, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l’esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière, sont incompatibles avec la vérité de l’homme. Elles sont d’ailleurs incapables de fonder la dignité de la personne.[3]
C’est la conscience humaine qui est désignée comme l’inconnaissable absolu ; le terme de conscience, que bien des biologistes contemporains attribuent à d’autres espèces que les humains et qui est susceptible de répondre à une définition insérée dans une histoire naturelle, est d’ailleurs évité au profit d’« esprit » ou d’« âme spirituelle ». Cette âme demeure le principe immatériel sur lequel aucun compromis n’est possible, dans la mesure où elle est l’émanation de l’esprit divin insufflé à « la seule de ses créatures qu’il aurait voulue à la fois “pour elle-même” et à son “image” » (Patrick Tort).
Le gros livre de Patrick Tort est un trésor, dont je suis convaincu qu’il fera date. Son ambition n’est pas mince : fournir le chaînon manquant du matérialisme, entre Darwin et Marx, entre l’approche matérialiste du vivant et celle des sociétés humaines. Ce n’est d’ailleurs pas seulement un chaînon manquant dont Tort déplore l’absence, mais au-delà du déficit – observable – de cohérence entre les percées darwinienne et marxienne, la construction d’une idéologie rendant impraticable le passage de l’une à l’autre. Cette idéologie porte un nom : le darwinisme social, d’autant plus mal nommé que son élaboration par Herbert Spencer (1820-1903) est antérieure à la publication par Darwin de L’origine des espèces. Les successeurs de Spencer s’emparèrent de l’idée de sélection naturelle pour l’appliquer à la société, plaidant contre toutes les mesures de protection sociale, susceptibles, selon eux, de biaiser la sélection naturelle et d’empêcher l’émergence des « meilleurs », des plus aptes à s’imposer. Il s’agit bien d’un détournement : Patrick Tort le montre pièces à l’appui, Darwin prit en son temps la peine de réfuter cette extrapolation abusive, dans La filiation de l’Homme, publié en 1871. Marx avait pour sa part découvert L’origine des espèces avec enthousiasme, célébrant l’abandon de la perspective téléologique qui, avant Darwin, dominait les tentatives de prendre en compte l’existence d’une évolution naturelle et de la succession des espèces vivantes. Il prit ensuite ses distances, précisément parce qu’il se méfiait dudit darwinisme social – comme Darwin lui-même, ce que manifestement, Marx a ignoré jusqu’à la fin de sa propre vie, n’ayant pas eu connaissance de l’ouvrage de Darwin qui réfute le darwinisme social. Les réticences exprimées par Marx ont de leur côté nourri un lourd héritage auprès de nombreux marxistes ou supposés tels, notamment lors de la fameuse affaire Lyssenko qui anéantit la biologie soviétique dans l’URSS stalinienne. Mais pas seulement, la lettre de Marx à Engels, si lapidaire soit-elle, a longtemps orienté la lecture de Darwin par les praticiens du social :
Il est curieux de voir comment Darwin retrouve chez les bêtes et les végétaux sa société anglaise avec la division du travail, la concurrence, l’ouverture de nouveaux marchés, les “inventions” et la “lutte pour la vie” de Malthus. C’est la bellum omnium contra omnes de Hobbes » (Lettre à Engels du 18 juin 1862).
Au contraire, Tort a épluché la réponse de Darwin aux « darwinistes sociaux », mettant en évidence ce qu’il appelle « l’effet réversif de l’évolution » :
Si importante qu’elle ait été, et soit encore, la lutte pour l’existence cependant, en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature de l’homme, il y a d’autres facteurs plus importants. Car les qualités morales progressent, directement ou indirectement, beaucoup plus grâce aux effets de l’habitude, aux capacités de raisonnement, à l’instruction, à la religion, etc., que grâce à la Sélection Naturelle ; et ce bien que l’on puisse attribuer en toute assurance à ce dernier facteur les instincts sociaux, qui ont fourni la base du développement du sens moral (Charles Darwin, La Filiation de l’Homme, chap. XXI)[4].
On ne réécrit pas l’Histoire, mais on peut regretter un rendez-vous manqué – même si Tort salue la perspicacité politique de Marx, qui avait un instinct politique assez sûr, ce qui l’avait conduit à prendre au sérieux et à ne pas sous-estimer l’impact idéologique de Spencer et de ses disciples. En d’autres termes, c’est l’amplification des tendances à l’altruisme et à la solidarité que l’évolution a favorisée chez les humains, et pas la capacité à se débrouiller dans un contexte régi par la loi de la jungle. Dans un langage plus moderne, cela revient à inscrire ces tendances altruistes dans le substrat biologique, voire génétique, des hommes, et pas seulement dans leur héritage culturel.
Mais revenons à nos moutons, et à un autre point nodal pour qui entend pourvoir sa vision matérialiste du monde en cohérence : la conscience humaine, à propos duquel Tort est loin d’enfoncer des portes ouvertes. On doit plutôt saluer l’exploit qui consiste à renouveler radicalement l’approche de la question, en suivant Faustino Cordón et Chomin Cunchillos, à qui Tort rend un hommage appuyé. Le premier (1909-1999) est le biochimiste espagnol qui a théorisé les unités de niveau d’intégration en biologie (pour faire bref, il s’agit de l’autonomie relative des sciences les unes par rapport aux autres), et le second a appliqué cette théorie à l’analyse des pratiques scientifiques en général.
Une conscience est une entité unitaire qui se définit par sa capacité à appréhender son environnement. Le terme « appréhender » a le mérite de faire d’une pierre trois coups, en incorporant dans la même définition
- l’action : l’acte d’appréhender compris dans toutes les dimensions sémantiques de ce terme qui sont liées à l’appropriation et à la saisie ;
- le ressentir : le fait d’éprouver sur soi un effet de l’environnement ou l’effet en retour de sa propre action sur l’environnement ;
- l’apprentissage : le réglage de l’action en fonction de l’information livrée par le ressentir.[5]
Premier mérite de cette définition, dont la complexité ne doit pas nous arrêter : elle pulvérise la distinction si souvent répétée entre conscience et conscience de soi, dont je ne suis pas loin de penser qu’elle est de nature à nous plonger dans une mise en abyme dont il est bien difficile de trouver la sortie. L’apprentissage implique une capacité de correction qui me semble définir bien plus clairement les processus conscients que la démarche introspective et nombrilesque associée à la « conscience de soi ».
La définition enfonce ses racines dans la science du vivant – ce n’est évidemment pas pour rien que Darwin est aussi présent dans la réflexion et dans le livre. Avec à la clé une surprise de taille : non seulement l’espèce humaine n’est pas la seule à être dotée de conscience, mais tout le règne animal l’est, en remontant jusqu’à ses formes les plus simples :
la seule différence que l’on puisse trouver entre l’état le plus primitif de l’une [la conscience] et la forme la plus développée de l’autre [la connaissance] est une différence de degré, et non de nature[6].
Cordón définit l’être vivant comme un « foyer d’action et d’expérience », et la conscience naît là où se fait l’ajustement de l’action en fonction de l’expérience (je paraphrase Tort), à savoir dans l’unité vivante du premier niveau d’intégration biologique – c’est précisément cette conscience qui cimente l’unité du regroupement en question. On peut donc même parler d’une conscience cellulaire, certes élémentaire, mais aux yeux de Cordón et de Tort, ce n’est pas un contre-sens. Le métabolisme est la base biologique de la conscience.
Je me sens personnellement trop mauvais connaisseur de la biologie pour exprimer un avis péremptoire sur ce qui précède, en particulier sur l’éventualité d’une forme de conscience au niveau cellulaire, mais je me suis plus qu’à mon tour égaré dans des discussions sans fin sur la conscience de soi pour apprécier pleinement la définition « opérationnelle » de la conscience proposée ici. Je vous dois cependant un aveu : je doute qu’elle convienne aux penseurs de l’âme.
La définition iconoclaste de la conscience avancée par Cordón s’inscrit dans une critique circonstanciée du réductionnisme, que les sciences pratiquent par ailleurs toutes. Mais il y a réductionnisme et réductionnisme : il faut distinguer le réductionnisme méthodologique, qui analyse les objets soumis à investigation en leurs composants élémentaires, réductionnisme inhérent à toute démarche scientifique, et ce que Tort appelle le réductionnisme catachrétique, terme choisi à dessein pour en souligner la nocivité (en grec, katachrêsis signifie mauvais usage ou abus). Il n’est pas excessif de parler d’abus, car ce procédé restreint la compréhension et l’explication visant un niveau d’intégration à celles qui ont fait leurs preuves à un niveau inférieur. Certes, ce réductionnisme abusif procède souvent d’une volonté de bien faire et s’inspire des succès des sciences – mais au prix d’une mutilation qui peut s’avérer désastreuse. Exemple de catachrèse : en affirmant que « les cellules sont les atomes du monde vivant », on file une métaphore trompeuse, parce qu’elle escamote une propriété essentielle des cellules, leurs capacités adaptatives. Sous une forme plus élaborée, on retrouve ici une idée qui, pour ne pas être neuve, reste utile : le tout est autre chose que la somme de ses parties.
C’est un second anneau manquant que Patrick Tort s’efforce ici d’insérer dans la chaîne matérialiste. Et pour ce faire, il oppose deux sources reconnues et célébrées du matérialisme, le tandem Démocrite-Leucippe, côté catachrèse, et épicure-Lucrèce de l’autre, qui évitent l’écueil. Ils sont tous atomistes – c’est en général ce qu’on retient –, non finalistes, mais le mérite d’épicure, c’est d’attribuer à ses atomes des degrés de liberté internes « qui rendent possibles les rencontres et brisent la chaîne des transmissions passives » (Patrick Tort). épicure intègre la contingence ; paradoxalement, le matérialisme exclusivement mécanique de Démocrite-Leucippe bloque l’explication matérielle du vivant. Et Tort de s’interroger : les théologiens ont cessé de faire barrage à l’histoire physique de la matière, ce qui revient à accepter la version leucippo-démocritéenne du matérialisme, tout en cultivant le discrédit à l’encontre d’épicure. N’est-ce pas parce que le réductionnisme catachrétique (j’ai plaisir à écrire le mot… ) rend impossible l’explication matérielle du vivant, de l’humain, de la morale et de la liberté, préservant ainsi l’espace d’un Inconnaissable, et par là même l’emprise des religions ?[7]
Notes
- Patrick Tort, Qu’est-ce que le matérialisme ?, éd. Belin, Paris, 2016, p.561. ↑
- La seule à laquelle il nous semble possible d’accorder un certain crédit… ↑
- Message du Saint-Père Jean-Paul II aux membres de l’assemblée plénière de l’Académie pontificale des Sciences, lien ↑
- Cité par Patrick Tort, op. cit., p. 350. ↑
- Patrick Tort, ibid., p. 51 ↑
- Patrick Tort, ibid., p. 54. ↑
- Patrick Tort, ibid., p. 65. ↑



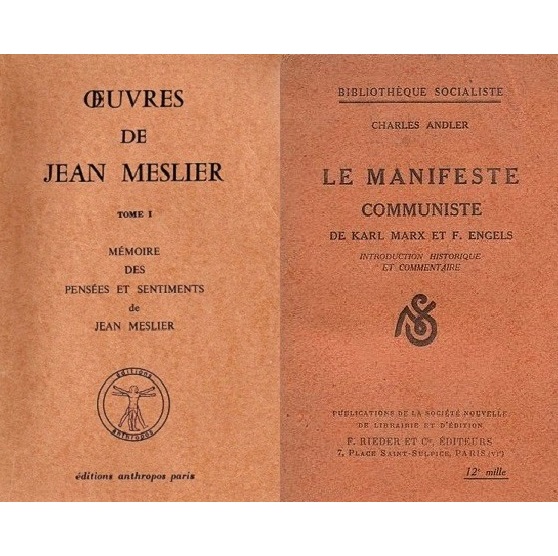
Vous devez être connecté pour commenter.