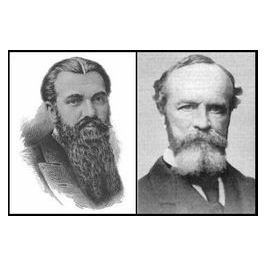
Peut-on croire sans raison ?
Au XIXe siècle, le mathématicien britannique William Clifford (1845-1879) et le psychologue et philosophe américain William James (1842-1910) abordaient, chacun au travers d’un texte, un débat sur ce que veut dire « croire » et sur ce qui peut justifier une croyance[1]. Bien que datant de la fin du XIXe siècle, ces deux textes importants de la philosophie anglo-américaine nourrissent un débat qui est toujours contemporain.
Pour l’illustrer, je vais commencer par une anecdote : mon cours de religion en dernière année d’humanités (la terminale en France) était divisé en trois parties : d’abord les preuves de l’existence de Dieu, ensuite les preuves que, parmi toutes les religions, la catholique était la meilleure, et enfin la doctrine de l’Église en matière sociale et sexuelle. La dernière partie était vue comme un corollaire de ce qui avait été « démontré » précédemment.
À la fin des années 1960, cette façon de défendre le catholicisme pouvait déjà paraître comme passablement « conservatrice ». Mais on a tendance à oublier que, pendant des siècles, cette démarche a été celle de l’Église : la croyance en Dieu et en la doctrine catholique n’était pas présentée comme une croyance aveugle et encore moins un choix subjectif, mais quelque chose de rationnel.
Néanmoins, au moins depuis le XVIIIe siècle, de nombreux penseurs ont montré qu’aucune des « preuves » de l’existence de Dieu (la cause première, l’argument de la finalité ou la preuve ontologique) ne démontrait quoi que ce soit. Face à cela, trois réactions étaient possibles : défendre ces preuves malgré tout (la tactique des bons pères qui pensaient m’éduquer), devenir athée ou inventer de nouveaux arguments en faveur de la religion.
C’est cette troisième attitude qui domine très largement le monde chrétien occidental contemporain. Mais ces arguments sont radicalement différents des arguments traditionnels en ce sens qu’ils ne cherchent pas à démontrer que les doctrines religieuses sont vraies mais qu’elles sont moralement utiles ou subjectivement satisfaisantes et ces arguments font principalement appel au sentiment plutôt qu’à la raison.
Tout le monde a déjà rencontré ce type de raisonnement : si Dieu n’existe pas, alors tout est permis. La croyance en Dieu nous console des misères de ce monde, nous permet de « nous sentir bien ». La croyance en Dieu est bonne pour les opprimés (théologie de la libération), pour les femmes (féminisme chrétien ou musulman) ou pour les peuples ex-colonisés (islam ou hindouisme politique).
Le mathématicien britannique William Clifford a avancé un argument allant exactement en sens inverse : un argument moral contre les croyances irrationnelles et qui est purement philosophique, en ce sens qu’il ne ressasse pas les critiques habituelles des incroyants à propos de l’Inquisition ou des Croisades qui, elles, dépendent de l’histoire[2].
Clifford donne l’exemple d’un propriétaire de navire qui sait ou devrait savoir que le bateau qu’il va mettre à la mer avec un certain nombre de migrants n’est pas très sûr. Il se convainc néanmoins que son bateau sera capable de faire le voyage. Malheureusement, celui-ci coule et les migrants se noient. Clifford en déduit qu’il était immoral pour l’armateur de se convaincre de la sécurité du bateau alors qu’il n’avait pas de bonnes raisons d’y croire.
Clifford insiste sur le fait que ce n’est pas simplement l’action du propriétaire (mettre le navire à la mer) qui est immorale, mais également la croyance non justifiée dans la sûreté du navire qui l’est. Et de là découle son éthique de la croyance : « on a tort, partout, toujours et qui que l’on soit, de croire sur la base d’éléments de preuve insuffisants. » (L’immoralité de la croyance religieuse p. 13)
Dans le reste de son texte, Clifford se défend de tomber dans le scepticisme et indique comment procéder pour arriver à des opinions justifiées, même si elles ne sont pas absolument certaines (Clifford accepte le caractère incertain de nos connaissances). Il n’y a là rien de très original : Clifford explique simplement comment procéder à des inductions raisonnables et sa démarche n’est pas différente de celle de la plupart des scientifiques.
La volonté de croire de William James est en partie une réponse à Clifford, bien que se voulant d’une portée plus générale. Pour James, l’éthique de la connaissance de Clifford est inapplicable parce que, dans bon nombre de situations, nous sommes obligés en pratique de choisir de croire une proposition ou sa négation sans disposer de preuves suffisantes pour effectuer ce choix. Si on suit l’éthique de Clifford, dit James, on évitera de tomber dans l’erreur mais on ratera également la possibilité de croire en des propositions vraies mais non prouvées. Le genre d’exemple que James aime donner c’est celui d’une demande en mariage : on ne peut pas attendre d’avoir de bonnes raisons de croire que la demande sera acceptée avant de la faire, sinon presqu’aucune demande de ce type ne serait formulée.
On pourrait répondre que cette objection ignore toute la partie du texte de Clifford où celui-ci explique comment nous pouvons arriver à des opinions justifiées, au moins en partie. Mais le but de James est de défendre les croyances religieuses, dont Clifford ne parle pas mais qu’il ne partageait manifestement pas. James estime que, concernant ces croyances, demander des preuves comme le fait Clifford, revient à adopter une position agnostique ou athée. Pour James, le fait de croire ou de ne pas croire est essentiellement une question pratique qui, comme pour d’autres questions, doit être décidée sans attendre d’avoir des preuves suffisantes pour trancher entre croyance et non-croyance. Suspendre son jugement en attendant de telles preuves revient pour James à faire un choix, celui de la non-croyance.
Cette attitude est reliée à la philosophie pragmatiste de James. Bien qu’il existe différentes versions du pragmatisme et que celle de James n’est pas entièrement claire, la partie la plus centrale mais aussi la plus problématique de cette doctrine consiste à ne pas voir une proposition vraie comme exprimant un état de fait, mais comme remplissant une fonction pratique, étant satisfaisante, utile, s’accordant au reste de nos pensées, etc. Une version radicale de cette idée (bien plus radicale que chez James[3]) est exprimée par le philosophe américain contemporain Richard Rorty lorsqu’il écrit : « Ce que des gens comme Kuhn, Derrida et moi pensons, c’est qu’il est inutile de se demander s’il existe réellement des montagnes ou s’il est simplement pratique de parler des montagnes. »[4]
Dans le chapitre qu’il consacre à James dans son Histoire de la philosophie occidentale[5], Bertrand Russell démolit cette notion pragmatique de la vérité : par exemple, si je me demande s’il est vrai que Christophe Colomb est parti pour l’Amérique en 1492, et que j’adhère à la notion ordinaire de vérité, comme reflétant un fait, je pourrais simplement consulter un livre d’histoire. Mais si je suis pragmatiste, je dois me demander s’il est utile de croire que Christophe Colomb est parti pour l’Amérique en 1492, plutôt qu’en 1491 ou 1493. Comment faire ? Et même si on résout ce problème (par exemple en se disant que donner 1492 comme date du départ permet de réussir des examens), il faut, pour être cohérent appliquer la notion pragmatique de vérité à l’assertion « il est utile de croire que Christophe Colomb est parti pour l’Amérique en 1492 », ce qui veut dire qu’il est utile de croire que cette assertion est vraie. On tombe ainsi dans une régression à l’infini.
Discutons des croyances irrationnelles
Pour finir, que penser de l’éthique de la vérité de Clifford et de la réponse de James ? La maxime de Clifford (« on a tort, partout, toujours et qui que l’on soit, de croire sur la base d’éléments de preuve insuffisants ») est correcte mais avec une nuance importante : il devrait ajouter « du moins, lorsque de tels éléments de preuve existent et nous sont accessibles », ce qui permet d’éviter l’objection de James concernant les nombreuses décisions pratiques, comme une demande en mariage, où un choix doit être fait sans nécessairement disposer de preuves allant dans un sens ou l’autre.
Pour ce qui est de James, la vision pragmatique de la vérité se heurte, comme le montre Russell, à des objections bien plus sérieuses que celle de la vérité comme correspondant à des faits. Mais, en ce qui concerne les croyances religieuses, il tombe dans le travers fréquent qui consiste à ne pas préciser de quelles croyances il s’agit. James était protestant ; donc, il ne croyait pas au dogme de l’immaculée conception ni aux autres dogmes spécifiquement catholiques. Il ne croyait pas non plus à la venue du Mahdi (croyance islamique) ni à celle du Messie (croyance juive) ni aux dieux de l’Olympe, amérindiens ou africains. Mais pourquoi au juste ? Comme pour le pari de Pascal, il ne suffit pas de croire, mais de croire dans la vraie foi, vu que la plupart des religions promettent un sort funeste, ici-bas ou dans l’au-delà, à ceux qui adhèrent à une religion autre que la « vraie », c’est-à-dire la leur. Justifier la croyance religieuse en invoquant ses bienfaits ne permet pas de se débarrasser de la question de la vérité (quelle est la vraie religion ?), du moins si on pense aux bienfaits résultant d’une action divine.
Il est vrai que James n’est pas très explicite sur ce en quoi consistent, pour lui, les bienfaits de la croyance. Est-ce la vie éternelle ou des consolations ici-bas ? Dans le deuxième cas, il suffirait de croire, peu importe la foi à laquelle on adhère. Mais reste la question, qui est une question de fait, du caractère bénéfique de la croyance : James ne semble pas se demander, par exemple, si la croyance à l’enfer pourrait avoir quelques inconvénients psychologiques. Par ailleurs, l’immense majorité des croyants n’adhèrent pas à une justification pragmatique de leur croyance. Pour eux, elle est vraie au sens de la vérité correspondant à des faits, d’où les infinis conflits entre croyances mutuellement contradictoires, conflits qui ne sont pas particulièrement bienfaisants.
Dans le débat entre Clifford et James, même si les arguments du second sont faibles, ce sont eux qui dominent l’opinion intellectuelle de notre temps, qui semble entièrement conquise à une vision de la vérité indifférente aux faits et qui se concentre uniquement sur les effets supposés de la croyance. Bien sûr, cette attitude a d’autres sources que le pragmatisme de James, la philosophie de Nietzsche par exemple, ou certaines versions du marxisme, et ce pragmatisme, comme dit Russell, « n’est qu’une forme de la folie subjectiviste qui caractérise la plupart des philosophies modernes »[6], mais ses ravages ne s’en font pas moins sentir : il est devenu quasiment impossible dans notre « culture » de discuter objectivement des croyances irrationnelles, en particulier religieuses. Reste à voir ce qui à terme fera le plus de tort : le subjectivisme contemporain ou les dogmatismes du passé.
Notes
- Ces deux textes viennent d’être republiés sous le titre L’immoralité de la croyance religieuse (Marseille, Agone, 2018, 125 p.). Il s’agit d’une nouvelle traduction en français, introduite et commentés par leur traducteur, le philosophe Benoît Gaultier, de L’éthique de la croyance de William Clifford et de La volonté de croire de William James qui en constitue une sorte de réponse.Clifford est connu (des spécialistes) pour ses travaux à l’intersection de la géométrie et de l’algèbre et qui a notamment suggéré, bien avant Einstein, un lien entre la force de gravitation et la géométrie de l’espace, idée qui est à la base de la relativité générale (1915). ↑
- Quand on avance ce genre d’arguments, les croyants répondent souvent en parlant d’Hitler, Staline, etc. et on arrive vite à une impasse. ↑
- Notons que James dit quand même : « Ici, dans cette salle, nous croyons tous à la réalité des molécules et à la conservation de l’énergie, à la démocratie et au progrès nécessaire, au christianisme protestant et au devoir de combattre pour la “doctrine de l’immortel Monroe”. Mais toutes ces croyances ne reposent sur aucune raison digne de ce nom ». (L’immoralité de la croyance religieuse pp. 55-56). Lorsqu’il écrivait ces lignes (1897), la conservation de l’énergie était quand même bien établie. Le fait qu’il la mette sur le même plan que le christianisme protestant et la doctrine de Monroe illustre son indifférence aux arguments scientifiques. ↑
- Richard Rorty, Truth and Progress. Philosophical Papers, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp 71-72. Je ne sais pas si Rorty reflète correctement l’opinion de Kuhn ou Derrida, mais il reflète sûrement la sienne. ↑
- Bertrand Russell, Histoire de la philosophie occidentale. En relation avec les événements politiques et sociaux de l’Antiquité jusqu’à nos jours, traduit de l’anglais par Hélène Kern, Paris, Les Belles Lettres, 2011, chapitre XXIX, pp. 923-931. ↑
- Ibid., p. 931. ↑

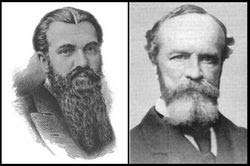



Vous devez être connecté pour commenter.