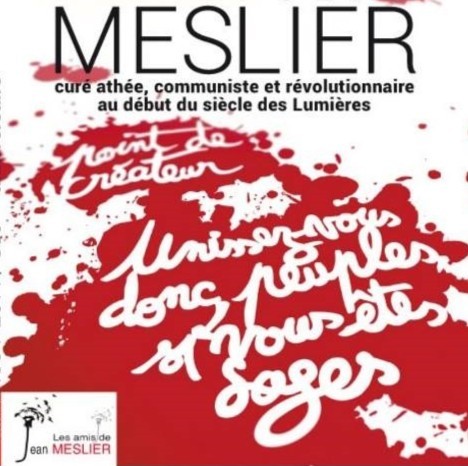Plutarque ou quand l’athéisme vaut mieux que la superstition
Patrice Dartevelle
Trop souvent, quand on parle de l’athéisme dans l’Antiquité gréco-romaine, on se cantonne à quelques noms de haute époque pour lesquels on ne dispose le plus souvent que de quelques phrases manifestant l’athéisme de leur auteur voire uniquement leur agnosticisme, comme c’est le cas de Protagoras. On cite Critias, Diagoras de Melos ou Théodore de Cyrène.
On n’hésite parfois pas à écrire que l’athéisme était sévèrement réprimé à Athènes et à Rome. Certes, l’athéisme a toujours été mal vu partout et à toutes les époques mais on ne trouve guère à travers les siècles qu’une seule loi athénienne contre l’athéisme et on ne manque pas de la citer comme preuve de la répression.
Ce serait au mieux une preuve de la rareté de la répression. Je veux parler du décret (athénien) de Diopeithès. En 433-432 avant J.C., un devin nommé Diopeithès, déjà moqué par des auteurs comiques, avait fait voter un décret condamnant l’impiété (asebeia) qui condamnait « ceux qui ne croient pas aux dieux et qui enseigneraient des doctrines relatives aux phénomènes célestes ».
C’est un témoignage unique, donné par Plutarque dans sa Vie de Périclès[1].
Les avis sont partagés sur le décret. Les uns en nient l’existence, d’autres supportent qu’il aurait été la base de l’accusation contre Socrate. D’autres, comme Plutarque lui-même, que je suis disposé à suivre, admettent que le décret est réel mais c’est un décret d’opportunité de la part d’un adversaire de Périclès. Celui-ci meurt en 429 et rien ne prouve que le décret ait jamais fonctionné.
Les siècles ultérieurs sont moins fréquemment cités et sont pourtant pleins d’intérêt voire de surprise.
Épicurisme et athéisme
Un élément central est complexe.
L’épicurisme revient souvent dans la question de l’athéisme et de sa confusion avec l’épicurisme. Celle-ci reste réelle mais illogique.
Dans l’Antiquité comme aujourd’hui, les épicuriens sont perçus comme des athées parce qu’ils contestent les mythes traditionnels et qu’ils sont atomistes.
Mais en réalité, les épicuriens croient aux dieux et ont même, c’est une vraie curiosité, une opinion tranchée et inverse de celle des autres philosophes sur la forme des dieux : pour eux, leur forme est humaine et il s’agit de dieux masculins comme de dieux féminins.
De toute manière, l’audience des épicuriens à la fin de la République romaine et aux premiers siècles de l’Empire est considérable.
Le cas le plus important est l’ouvrage fondamental de Cicéron, écrit entre 45 et sa mort en 43, le De natura deorum (De la nature des dieux)[2].
Dans cette œuvre en trois parties, Cicéron, qui est d’inspiration platonicienne pour sa part, invite pour chaque partie un philosophe particulièrement représentatif de son école.
Le Livre I donne la parole en premier à Caius Velleius, un sénateur – c’est-à-dire un personnage de première importance – que Cicéron nous présente comme l’épicurien de Rome le plus écouté.
Cicéron connaît bien l’épicurisme : dès 90 (il est né en 106), il a écouté à Rome les conférences de l’épicurien Phèdre et a retrouvé ce dernier à Athènes en 79, année où il a également suivi les leçons du chef de l’École épicurienne, Zénon de Sidon.
De fait, Velleius expose de manière parfaitement correcte la doctrine d’Épicure. Écoutons-le, même si l’argumentation est surprenante :
Seul il (Épicure) a compris, en premier lieu, que les dieux existent, parce que c’est la nature elle-même qui en a imprimé la notion dans l’esprit de tous. Quel est en effet le peuple, quelle est la race d’hommes qui, sans avoir reçu d’enseignement, ne possède une connaissance anticipée des dieux ? C’est ce qu’Épicure appelle prolepsis, c’est-à-dire une sorte de représentation formée auparavant dans l’esprit sans laquelle rien ne peut être conçu ni recherché ni discuté[3].
Et plus loin :
Épicure donc […] enseigne que ce qui caractérise la nature des dieux est que, en premier lieu, elle n’est pas perçue par les sens mais par l’esprit […] par des images perçues grâce à leur similarité et à leur fréquence : en effet, une forme constamment renouvelée d’images parfaitement semblables se présente à partir d’atomes innombrables suivant un flux continu[4].
On peut demeurer étonné de la faiblesse de l’argument selon lequel on ne connaît aucun peuple qui n’ait pas de dieu. On pourrait croire à une médiocre apologétique chrétienne. Mais le concept de prolepsis, même si ici l’argumentation est élémentaire, fait au fond penser à certaines théories linguistiques du structuralisme (Chomsky…).
Le meilleur spécialiste français de la religion, le philosophe Daniel Babut, reconnaît bien là la théorie des épicuriens[5]. C’est assez loin de l’image de l’athéisme épicurien qu’on se faisait dans l’Antiquité et encore souvent de nos jours.
Velleius s’empresse d’ailleurs d’ajouter « Mais nous n’avons rien à redouter des puissances du ciel ». Pourquoi ? Parce que, dit-il, « Nous avons donc cette prénotion qui nous fait penser que les dieux sont bienheureux et immortels »[6]. Nous n’avons donc rien à redouter des puissances du ciel » et plus précisément en reprenant la première maxime d’Épicure : « Ce qui est bienheureux et éternel n’éprouve aucun souci et n’en cause aucun à autrui, aussi ne ressent-il ni colère ni bienveillance car de tels sentiments sont des manifestations de faiblesse. »[7].
Et quant à la forme des dieux, c’est d’un parfait simplisme : « Si la figure humaine est supérieure à la forme de tous les êtres vivants, dieu étant un être vivant, sa figure est assurément la plus belle de toutes. »[8]
Ici sur ce qui sont et ce que font les dieux, la rupture est totale, spécialement avec l’École philosophique rivale, celle des stoïciens. Velleius s’en prend explicitement aux stoïciens. Il décrit ainsi la vie des dieux : « Dieu ne fait rien, il ne se livre à aucun travail, sa sagesse et sa vertu lui apportent la joie, il a la certitude de vivre toujours au milieu de plaisirs non seulement extrêmes mais éternels »[9] et, s’en prenant à son adversaire stoïcien Balbus « Voilà le dieu que nous pouvons à bon droit appeler bienheureux tandis que le vôtre est vraiment surchargé de travail[10].
Malgré sa réputation, parfaitement erronée, d’athéisme, l’épicurisme est pris parfaitement au sérieux dans les milieux les plus importants. Velleius est sénateur et son interlocuteur Balbus l’est également.
La prise en compte de l’épicurisme est donc notoire au Ier siècle avant J.C. malgré les scandales des dieux qui ne s’occupent d’absolument rien.
Plutarque
Sous une forme un peu particulière, l’athéisme revient dans la littérature au Ier siècle après J.-C., grâce à Plutarque, l’un des auteurs antiques dont il nous reste le plus de textes.
Plutarque naît vers 46 et meurt vers 125. De 96 à sa mort, il est l’un des dix prêtres du temple d’Apollon à Delphes.
Au plan philosophique, c’est un moyen platonicien, une école bien postérieure à Platon mais antérieure au néo-platonisme de Plotin[11]. Mais Plutarque est aussi et surtout un homme très religieux à tel point que parfois on a cru trouver chez lui la trace d’u concept-clé du christianisme, celui de foi.
Comme je l’ai déjà exposé par ailleurs, l’opinion plus que dominante est que l’idée de foi (pistis en grec) en religion n’existe pas dans le paganisme. Elle apparaît progressivement dans le christianisme.[12]
Mais quelques textes de Plutarque font difficulté à cet égard. Il s’agit de passages dans Sur l’Amour, 756b, Sur les oracles de la Pythie, 402e et De l’impossibilité de vivre agréablement en suivant Épicure, 1101c. Chaque fois il s’agit d’expressions comme « la croyance ancestrale de nos pères », « les pieuses croyances de nos pères », ou « la croyance que la plupart ont au sujet des dieux ». Il s’agit toujours de croyances qu’il ne faut pas abandonner.
Daniel Babut estime que « […] Plutarque affirme ici la valeur de la foi (pistis) comme source spécifique de la croyance religieuse. Bien plus, il admet implicitement qu’il peut y avoir conflit entre ces deux sources de la connaissance religieuse, et tranche délibérément en faveur de la seconde et de son évidence supra rationnelle »[13]
En fait, la fin de la phrase trahit une préoccupation particulière de son auteur. D. Babut veut, non sans vraisemblance, mettre davantage en évidence l’influence de l’école sceptique sur Plutarque.
Pour D. Babut « l’impasse à laquelle aboutit la philosophie justifie aux yeux de Plutarque son dépassement et le scepticisme de la Nouvelle Académie, une des appellations du moyen platonisme, auquel il donne son adhésion, le conduit à séparer du domaine de la connaissance rationnelle celui de la croyance religieuse et à en affirmer l’autonomie ».[14]
D’autres spécialistes l’ont suivi dans cette voie, mais pas tous, loin de là.
D’autres spécialistes, comme Françoise Frazier, ne manquent pas de relever que « Tous ces passages concordent pour donner à patrios pistis (la foi/la croyance des pères) une valeur plus objective que subjective[15].
De toute évidence, puisque Plutarque, ni dans ces passages ni ailleurs, n’explique ni ne commente le choix du terme, il s’agit d’un processus inconscient.
Comme le conclut Françoise Frazier, après d’autres philologues : « Rien dans les textes ne peut corroborer une conceptualisation de la pistis ». Le caractère limité des expressions dans les textes cités et l’absence de contexte forcent les spécialistes à suspendre le jugement et à en rester sur la position classique.
Rien ne prouve que le paganisme antique ait connu quelque chose qui ressemble à la foi chrétienne, concept qui a d’ailleurs mis un peu de temps à s’élaborer et s’imposer.
Pour comprendre ce qui tracasse Plutarque en matière religieuse et en ce qui concerne la superstition, il faut prendre en considération la situation religieuse de la fin du Ier siècle et du début du IIe siècle.
La situation est devenue instable. L’époque hellénistique a vu une critique des mythes. Ceux-ci ont fini par inspirer la méfiance.
Comme le dit John Scheid « […] sous le Haut-Empire, les citoyens sont en quelque sorte disponibles pour une conversion plus profonde, quand le modèle traditionnel n’est plus convaincant ». Dès lors, il y a débat entre plusieurs positions. J. Scheid explique clairement les enjeux entre « Ceux qui veulent reproduire, sans y toucher, le système des valeurs antiques opposant la religion publique, vénérable et pure, à un ensemble de superstitions ridicules et pernicieuses, repaires de l’erreur » et « d’autres, qui inscrivent l’histoire de la religion romaine sur une courbe qui mène au triomphe du christianisme, inversent les signes : à un cadavre méprisable s’oppose maintenant la fraîcheur des superstitions, prêtes à entrer dans la grande histoire »[16].
Traiter à cette époque de la superstition n’est pas anecdotique : c’est participer à un grand débat, dont, sans doute, les intervenants n’ont pas comme nous le moyen de connaître l’issue.
Le De superstitione de Plutarque
C’est ici qu’intervient Plutarque et son traité sur la superstition, rare par son importance.
Jeune encore, même si on ne peut dater l’œuvre avec certitude, il écrit entre 70 et 80 un traité sur la superstition, attitude qu’il oppose à la religion et à l’athéisme[17].
Plutarque est religieux et sa position ne va pas de soi : il traite athéisme et athées avec un respect dont ne bénéficient pas la superstition et les superstitieux. Tentons d’en saisir les arguments et les positions qu’il exprime[18].
Comparant d’emblée athéisme et superstition, Plutarque affiche davantage de compréhension à l’égard de l’athée (chap. 2).
Ainsi l’athéisme, bien qu’il soit
la pensée fausse qu’il n’existe aucun bien souverain et incorruptible, semble nous réduire à une sorte d’indifférence par négation » […] La « superstition est une opinion entachée de passion, une supposition créatrice d’une crainte qui déprime et brise l’homme par la croyance qu’il existe bien des dieux, mais qu’ils sont méchants et nuisibles.
Faisons attention que le terme que nous traduisons, comme les Latins, par « superstition » signifie étymologiquement « crainte des dieux ou des démons (deisidaimonia).
De là la première opposition entre athéisme et superstition : « […] l’athéisme est un raisonnement faussé, la superstition une passion mêlée d’un raisonnement faux ».
L’athée est un homme qui « reste ferme » dans sa conviction, le superstitieux « s’agite et se livre à des mouvement inconvenants ».
En croyant rationnel, Plutarque a horreur des passions en ce que « sous la contrainte des impulsions, elles exercent une pression sur le raisonnement et lui font violence » et de conclure « nous, ce sont les prières aux dieux que nous demandons d’adresser « d’une bouche juste et droite », et non pas d’examiner si, parmi les viscères des victimes, « la langue est pure et droite ».
Celui qui craint les dieux ne peut trouver un endroit où ils n’existent pas. La superstition ne permet pas de changer de dieux. Même la mort n’arrange rien : elle fait penser aux châtiments éternels.
Plutarque constate : « Rien de tout cela ne s’applique à l’athéisme ».
Poursuivant son réquisitoire : « L’athéisme est un état d’insensibilité au divin sans l’idée du bien, la superstition un excès de sensibilité avec l’idée latente que le bien est un mal », c’est-à-dire que les dieux sont dangereux.
Si des malheurs imprévus surviennent, l’athée accepte les événements et se console. Le superstitieux, dans cette situation, reste accablé et rend les dieux responsables de ses maux. L’athée recherche la cause des problèmes, le superstitieux n’ose pas intervenir parce qu’il ne peut combattre les dieux. Face aux malheurs, le superstitieux se dit à lui-même : « Tu subis des maux, misérable, par l’effet de la providence et sur l’ordre de la divinité ».
Lors des festins et des fêtes autour des temples, l’athée rit devant ces pratiques et dit à ses voisins que les gens qui s’imaginent s’adresser aux dieux sont aveugles. Le superstitieux ne parvient pas à s’associer à la fête, il a peur et sacrifie.
Plutarque en arrive à sa principale affirmation, sous la forme d’une interrogation purement rhétorique.
« Celui qui croit que les dieux n’existent pas est un sacrilège, mais celui qui les croit tels que les imaginent les superstitieux ne partage pas des opinions bien plus sacrilèges ? ». Il termine par une formule que d’autres reprendront : « Pour ma part […] j’aimerais mieux que les hommes disent de moi que Plutarque n’a nullement existé et n’existe pas plutôt que de les entendre dire que Plutarque est un homme inconstant et versatile, enclin à la colère, vindicatif au moindre sujet, s’affligeant pour un rien ».
S’ensuivent les trois reproches principaux adressés au superstitieux.
Le premier, quelque peu forcé, avouons-le, consiste à affirmer que le superstitieux est un ennemi des dieux et surtout qu’il est un athée qui n’ose pas l’être : le superstitieux désire au fond qu’il n’y ait pas de dieux mais ne pas croire lui fait peur. Le superstitieux « préférant être athée (mais) il est trop faible pour avoir sur les dieux l’opinion qu’il veut ».
Le deuxième est que la superstition favorise l’athéisme. En effet, ce sont les faits de sorcellerie et de magie, les purifications et expiations, les mortifications barbares devant les temples qui ont convaincu certains que mieux valait qu’il n’y ait pas de dieux.
Et enfin, à voir certains penser que les dieux se réjouissent de l’égorgement de l’homme et pensent que c’est là le sommet du sacrifice et du rite, de quelle morale se réclame les religions ?
Il faut donc fuir la superstition mais de manière réfléchie. Sinon on risque de rejeter « dans le terrain abrupt et dur de l’athéisme », au lieu de choisir le juste milieu de la piété. C’est un peu la classification de Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne, l’islam étant la superstition, le catholicisme étant la piété et le moyen terme entre l’islam et l’athéisme.
Une idée surprenante
L’idée de base du traité de Plutarque sur la superstition a pu sembler surprenante à certains commentateurs, Plutarque étant religieux. Mais les préoccupations philosophiques de Plutarque et ses critiques des mythes traditionnels montrent bien que nous sommes en présence d’un homme qui est conscient des divergences religieuses de son époque, de l’éloignement de celle-ci par rapport au contexte des siècles antérieurs.
Nous n’avons aucun texte explicite en ce sens mais Plutarque souhaite peut-être faire voir la menace devenue proche présentée par l’athéisme. Plutarque est subtil, sa cible n’est-elle pas l’athéisme ?[19]
Déconcertés, certains commentateurs ont insisté sur la jeunesse de Plutarque lorsqu’il écrit le De superstitione, considérant que ce n’est qu’un exercice scolaire purement formel. D’autres – ou les mêmes – ont préféré tenter de montrer que beaucoup plus tard, Plutarque avait renoncé à sa position initiale exprimée dans le De superstitione, à savoir que la superstition est pire que l’athéisme.
Mais Paul Veyne, dans un long article approfondi sur la religion de Plutarque, tout en reconnaissant la différence apparente, conteste sa réalité : les deux ouvrages visent des publics différents, le De superstitione, qui vise les lettrés et l’autre la foule illettrée[20].
Trois textes sont évoqués et pour ma part, j’en déduis que la distinction des publics n’est pas nécessaire et que Plutarque n’a pas fondamentalement varié.
Tous proviennent du traité Isis et Osiris, écrit après 120. Lisons-les[21].
En 355 D, on lit en effet « Tu éviteras un mal aussi grave que l’athéisme, la superstition ». C’est vrai qu’ici il y a égalité entre les deux mais cela reste surprenant, même si ça l’est moins que la version du De superstitione.
En 379 A, on lit : « […] certains se fourvoient complètement en glissant dans la superstition ; d’autres, fuyant les fondrières de la superstition, vont à l’opposé, se jeter dans le gouffre de l’athéisme ». Plus difficile encore de hiérarchiser un gouffre et des fondrières.
Mais en 379 D, on y voit clair et on retrouve le De superstitione :
Ils [les Égyptiens] ont enraciné une croyance dangereuse [honorer les animaux pour eux-mêmes et les traiter comme des dieux] qui précipite les esprits faibles sans malice dans la superstition pure et simple et fait tomber ceux qui ont plus de pénétration et d’audace dans la brutale logique de l’athéisme.
Qui nierait que les mots les plus élogieux vont à l’athéisme ?
Parler comme J. Scheid de courbe qui mène au christianisme n’a peut-être pas l’évidence fatale qu’il semble voir dans le cours de l’histoire et le mot de la fin semble bien revenir à Lactance, auteur chrétien des Institutions divines (vers 313-315), qui exprime le concept chrétien de superstitio (en 4, 28, 11) : « la religion est le culte du vrai dieu, la superstition celui du faux ». C’est brut et net.
J’ai voulu retracer un élément de l’évolution religieuse de Cicéron à Plutarque mais j’ai surtout voulu montrer que l’athéisme à ces époques, même si l’on ne dispose pas d’un texte disant : « je dis que les dieux n’existent pas », est présent dans les questionnements philosophiques et religieux de ces époques.
Je conclurai avec Tim Whitmarsh, le plus récent auteur d’une synthèse sur l’athéisme antique : « L’athéisme a été un phénomène largement répandu et bien compris pendant le Haut Empire romain »[22].
[1] Plutarque, Vie de Périclès, 32,1.
[2] J’ai utilisé Cicéron, la nature des dieux, traduit et commenté par Clara Auvray-Assayas, Paris, Les Belles Lettres, collection La roue à livres, 2002.
[3] De natura rerum, I, XVI, 43.
[4] Op.cit I, XIX, 49.
[5] Daniel Babut, La religion des philosophes grecs, Paris, PUF, 1974, chapitre V, pp. 139-171.
[6] De natura deorum, I, XVII, 45.
[7] Op cit I, XVII, 45.
[8] Op cit I, XVIII, 48.
[9] Op cit I, XIX, 51.
[10] Op cit I, XIX, 52.
[11] Bien entendu, Plutarque ne s’est jamais perçu comme un médio-platonicien. Le concept a été forgé en 1908 par K. Praechter, ainsi que le rappelle Carlos Levy in « Chronique de philosophie antique. Plotin lecteur d’Épicure. À propos d’un livre récent », BAGB,2023/2, p. 204.
[12] Patrice Dartevelle, « Foi, religion, croyance : de quoi parle-ton ? », in Pourquoi croit-on en Dieu, Bruxelles, ABA Éditions, 2023, pp 19-23.
[13] Daniel Babut, Plutarque et le stoïcisme, Paris, 1970, p. 515.
[14] Ibid p 518.
[15] Françoise Frazier, « Philosophie et religion de la pensée de Plutarque », in Études Platoniciennes, 5 (2008), pp 41-61.
[16] John Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, Éditions La Découverte, 1985, voir p.p 133-134. J. Scheid, professeur au Collège de France, est l’un des meilleurs spécialistes de Rome et de la religion romaine.
[17] Plutarque n’est pas l’inventeur du mot (atheotès) que l’on trouve déjà chez Platon, Lois, 967c.
[18] Je lis le texte et la traduction de Jean Defradas, Jean Hani et Robert Klaerr, in Plutarque Œuvres morales, tome II, Collection des Universités de France, Paris, Les Belles Lettres, 1985, pp 239-267 pour l’introduction, le texte et la traduction (ceux-ci vont des pages 248 à 267), et pp 344-351 pour les notes complémentaires.
[19] C’est l’interprétation de Tim Whitmarsh, Battling the Gods – Atheism in the Ancient World, Londres, Faber & Faber, 2016, 290 p., voir p. 228.
[20] Paul Veyne, « Prodiges, divination et peur des dieux chez Plutarque », in Revue d’histoire des religions, 1999, pp. 387-442, voir p.436.
[21] Je lis le texte et la traduction de Christian Froidefond, in Plutarque, Œuvres morales, Tome V, 2e partie, Traité 23, Isis et Osiris, Collection des Universités de France Paris, Les Belles Lettres, 2022.
[22] Tim Whitmarsh, op.cit, p.230.
Post a Comment
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.